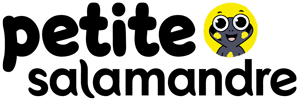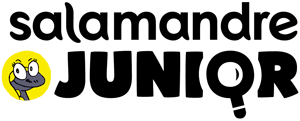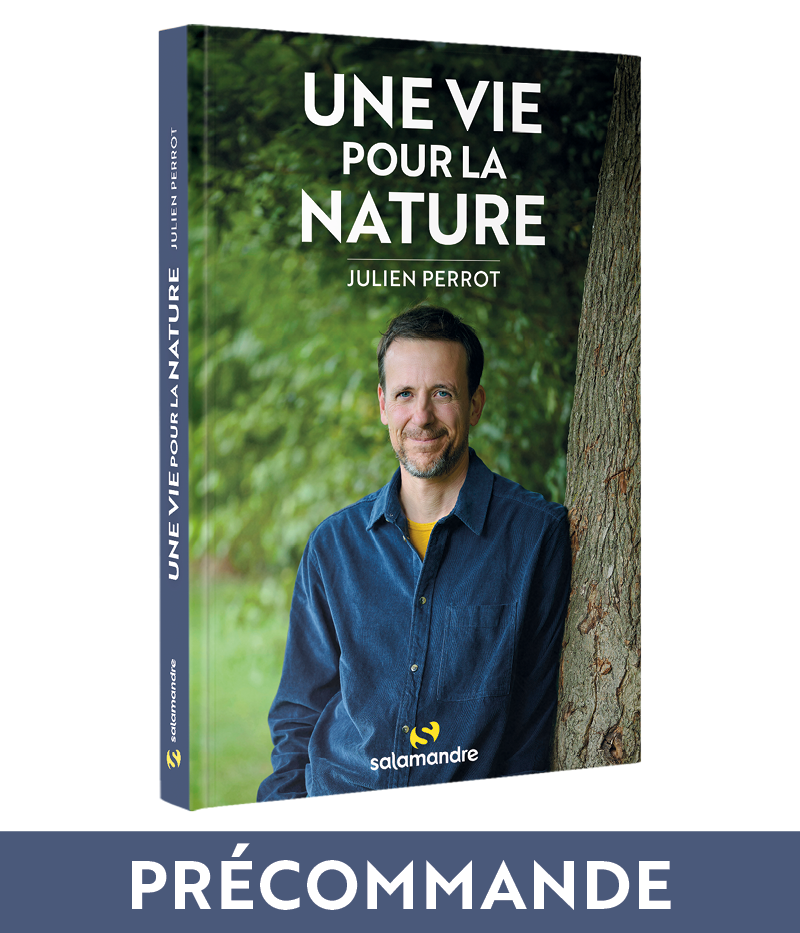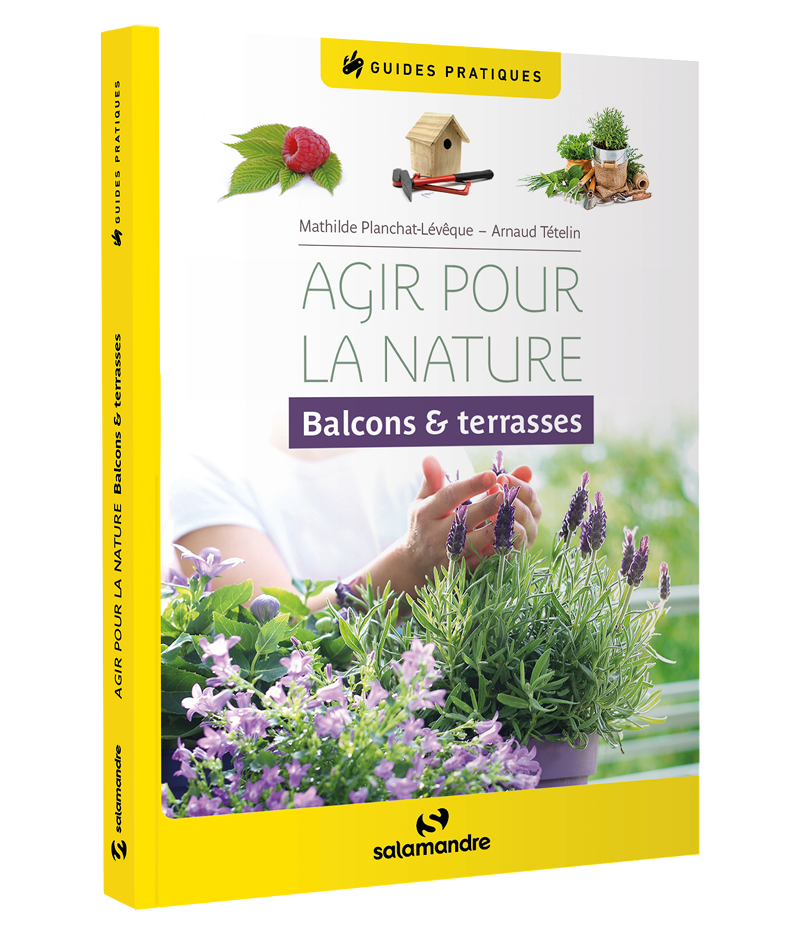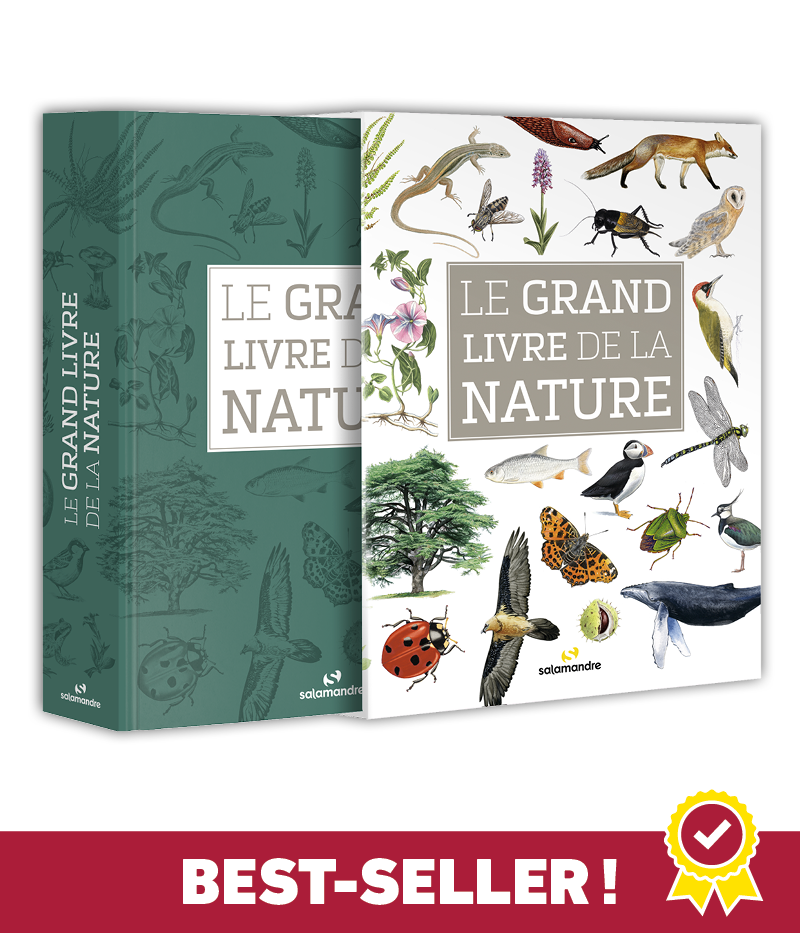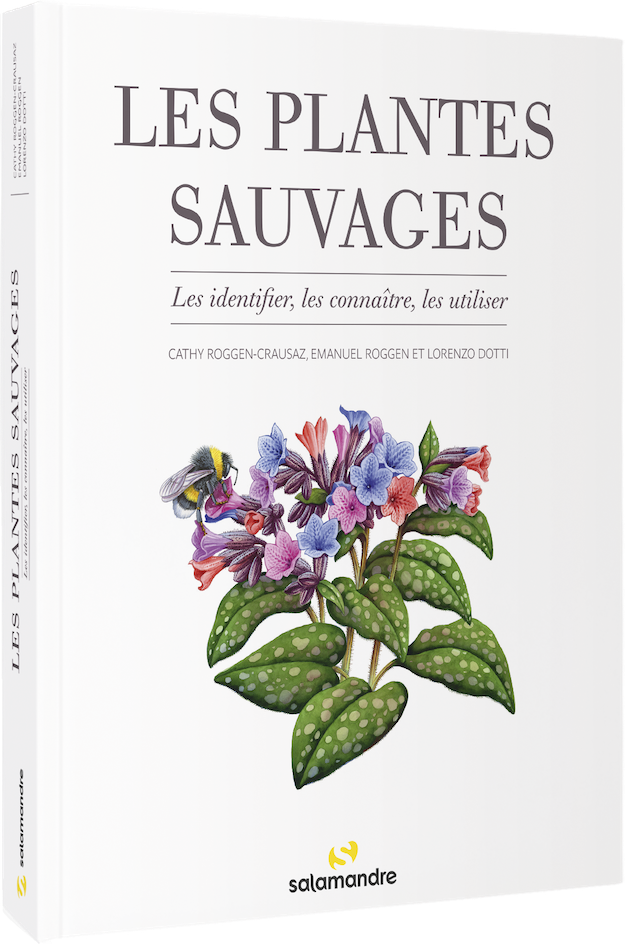Voyage sous terre à la découverte d’un bouquet émeraude
Le photographe et hydrogéologue Philippe Crochet revient sur sa rencontre avec un joyau minéral. Direction le sous-sol languedocien.
Le photographe et hydrogéologue Philippe Crochet revient sur sa rencontre avec un joyau minéral. Direction le sous-sol languedocien.

Philippe Crochet a commencé la spéléologie à 16 ans et s’est rapidement spécialisé dans la photo souterraine. Sa passion pour le monde minéral l’a amené à l’hydrogéologie. Avec son épouse Annie, ils parcourent le monde à la recherche des grottes les plus insolites et ont déjà publié plusieurs livres sur cet univers singulier. Son site : philippe-crochet.com

Lorsqu’en 1978, je me suis retrouvé pour la première fois devant ces inflorescences improbables, je n’en ai pas cru mes yeux. Je n’étais pas en présence de mousses ou de feuilles au fond d’une quelconque forêt perdue, mais dans un univers purement minéral et obscur où la chlorophylle n’a pas lieu d’être. C’est dans l’aven du mont Marcou, une cavité à l’ouest de l’Hérault, que se situe cette merveille. Les spéléologues locaux l’avaient découverte quelques années auparavant et l’avaient gardée secrète pendant un certain temps afin de la protéger. Pour y accéder, il fallait descendre une série de puits avant d’escalader une pente boueuse en haut de laquelle se trouvait une petite lucarne, débouchant sur une minuscule alcôve remplie d’aragonite d’un vert éclatant. On ne connaît pas ailleurs dans le monde une telle quantité de concrétions vertes en cavité naturelle. Je faisais alors partie des rares privilégiés à pouvoir photographier cette splendeur minérale.
À l’époque, j’ai fait une série de diapositives, car c’était bien avant l’avènement du numérique. J’ai dû me limiter à des plans moyens ou rapprochés, pour mettre en lumière les concrétions elles-mêmes, plutôt que le contexte. Il faut dire que la prise de vue n’est pas facile : l’endroit est resserré, on ne peut y tenir debout qu’à trois personnes au maximum. Et la fragilité du milieu requiert de se mouvoir avec d’infinies précautions. Conséquence : peu de recul pour les plans d’ensemble et les éclairages.
Bien des années plus tard, en 2021, j’y suis retourné pour une nouvelle séance photo, afin de compléter le livre Symphonie en sous-sol sur lequel je travaillais. Les concrétions étaient restées intactes et les traces de boue avaient été nettoyées. Les conditions d’accès avaient également bien changé : dorénavant, l’escalade était sécurisée par une échelle fixe permettant d’accéder aisément à l’alcôve. Avant de monter, chaque visiteur enlève sa combinaison sale dans une tente disposée à cet effet et lave ses chaussures afin de ne pas souiller les lieux. Tous ces aménagements ont été effectués par l’association Mont Marcou, créée en 2002 pour protéger le site. L’accès à la cavité est depuis lors régulé par un arrêté ministériel qui limite le nombre de visites à quatre par an, avec l’encadrement de spéléos habilités

Les nouvelles conditions ainsi que mon équipement photo d’aujourd’hui m’ont permis de faire cette image, différente de mes premiers clichés. J’ai choisi le cadrage le plus large possible en intégrant dans la composition de la photo mon épouse qui débouche dans l’alcôve par la lucarne, et découvre admirative le spectacle qui s’offre à elle. La présence humaine permet ainsi de donner l’échelle, ce qui est important dans un contexte aussi peu commun. De plus, le public peut se projeter dans l’image, voir la scène à travers son regard et peut-être ainsi éprouver un peu de son émotion.
Le saviez-vous ?
Vert d’eau
La spéléologie n’est pas qu’un loisir, c’est aussi une activité qui implique plusieurs domaines scientifiques, dont la géologie. Aussi, les spéléologues ont eu à cœur de comprendre d’où venait cette couleur verte qui leur était inconnue. Ils se sont associés pour cela à une équipe de recherche de Namur. Les analyses très poussées (DRX, MEB, spectroscopie…) effectuées sur un microprélèvement ont révélé que la coloration était due à un minéral très riche en nickel, la népouite, qui enrobe les concrétions d’aragonite habituellement blanches. Sa présence est la conséquence d’une réaction en chaîne liée à l’oxydation des pyrites présentes dans une couche de grès surmontant la cavité calcaire. L’eau s’infiltrant à travers la roche depuis la surface apporte ainsi ce minéral dans l’alcôve.

Studio enfoui
Outre l’avènement du numérique, l’une des principales évolutions du matériel depuis les années 1980 pour la photographie souterraine est la gestion des flashs. Maintenant, ils sont déclenchés depuis l’appareil photo par des émetteurs radio permettant également de régler à distance leur puissance et leur angle d’éclairage. Quatre flashs électroniques ont été utilisés pour cette photo : deux croisés à 45° donnant l’éclairage général de la scène, un en contre-jour derrière le modèle et un dernier pour éclairer son visage. Cette disposition de l’éclairage reprend les techniques de studio. Face aux beautés de la nature, Philippe Crochet affectionne cette démarche illustrative dont le but est de mettre en valeur les sujets géologiques le plus fidèlement possible.


Cet article est extrait de la Revue Salamandre
Catégorie
Ces produits pourraient vous intéresser
Poursuivez votre découverte
La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille
Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous
Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature
Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique
merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur