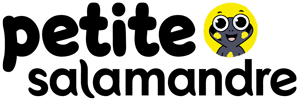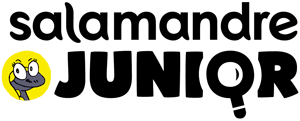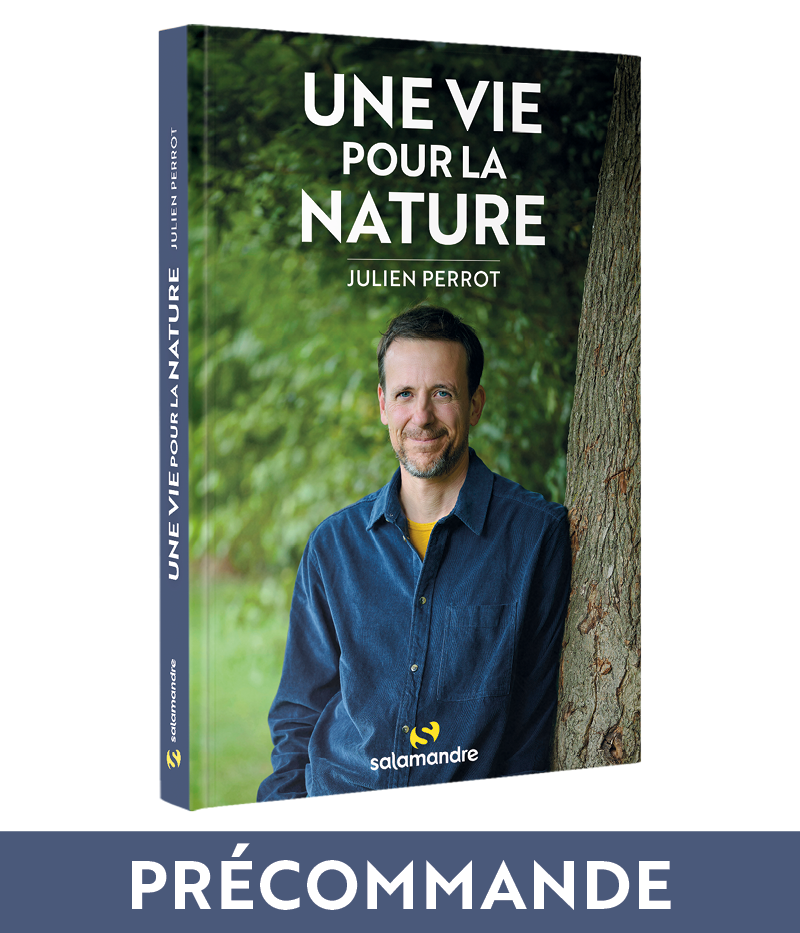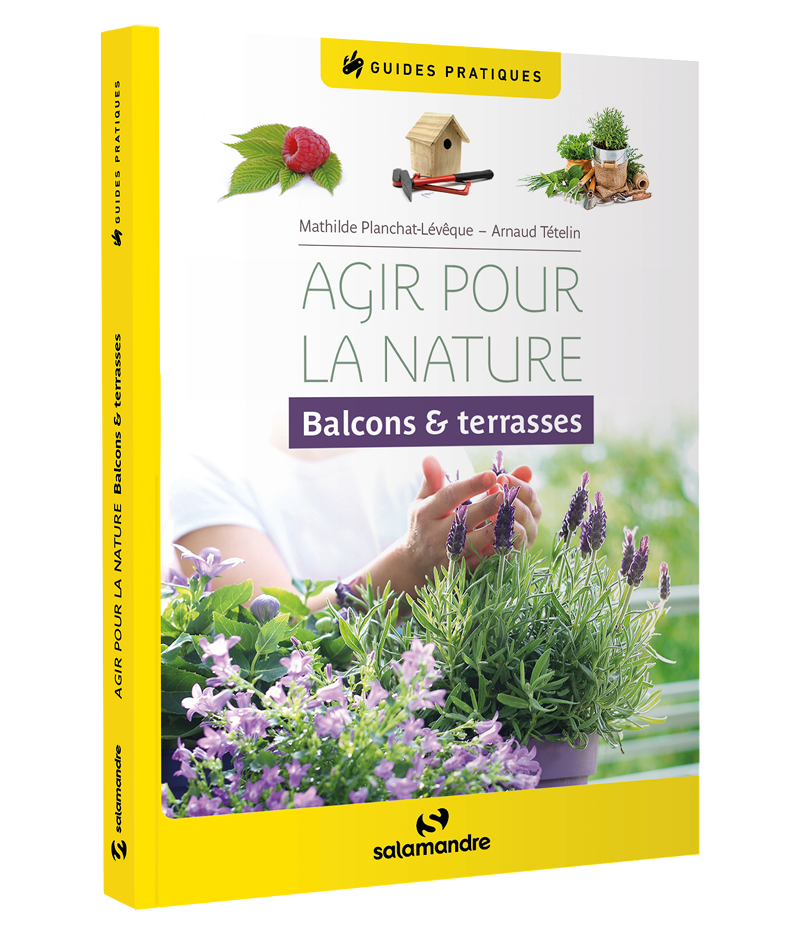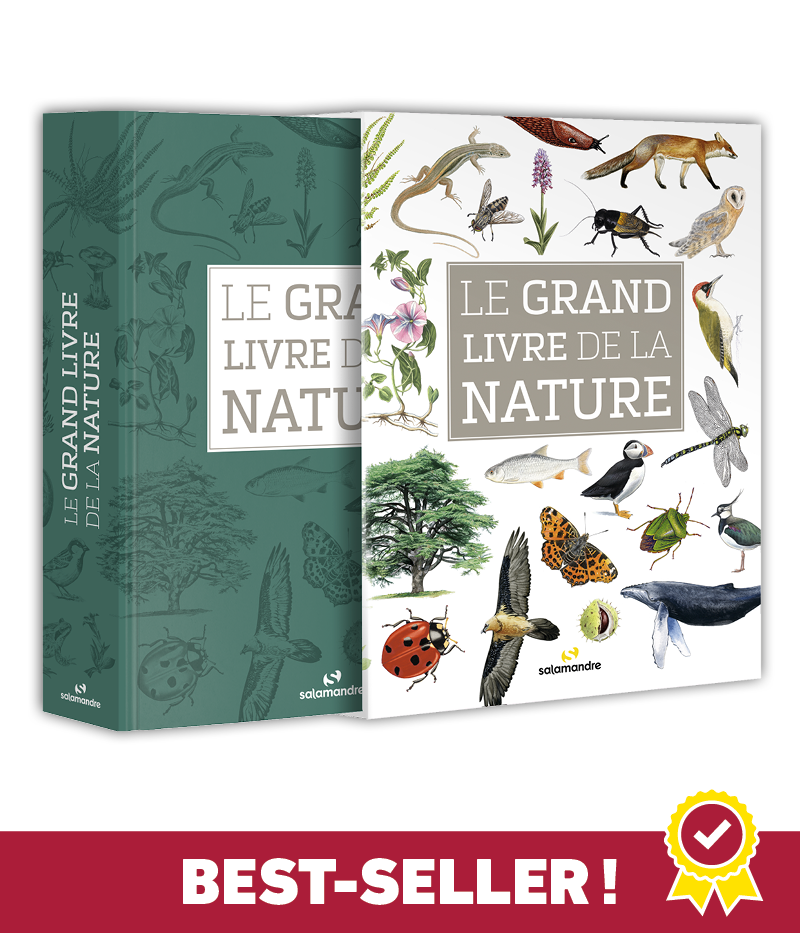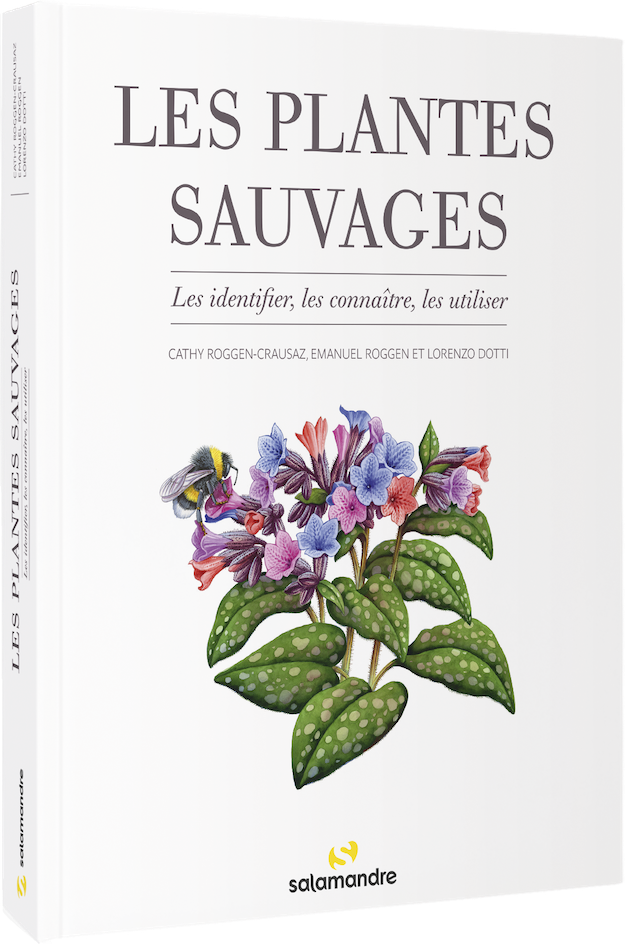Pas encore de V de la victoire pour les grues
Si les grues reviennent en beauté en Europe après avoir frôlé l’extinction, quelques mauvaises surprises les attendent encore en chemin. Tour d’horizon.
Si les grues reviennent en beauté en Europe après avoir frôlé l’extinction, quelques mauvaises surprises les attendent encore en chemin. Tour d’horizon.
Renaître de ses cendres
La grue est un miroir de la santé des milieux humides : quand ceux-ci vont mal, elle aussi. Au Moyen Âge, la vaste plaine marécageuse des Landes de Gascogne accueillait cet oiseau alors quasi banal en nidification, comme presque partout en Europe. « Mais, dès 1 800, notre cher Napoléon est venu assécher le paysage landais pour planter massivement des pins maritimes », lâche Xavier Chauby, garde naturaliste à la réserve d’Arjuzanx, en Aquitaine. Les drainages qui se généralisent sur tout le continent à cette époque s’ajoutent à la pression cynégétique. Déjà rayées de l’Irlande et de l’Angleterre, les nicheuses disparaissent de toutes parts au fil des décennies : France, Pays-Bas, Danemark, République tchèque, Italie, Hongrie… « Au plus bas, il ne reste que 20 000 grues en Europe », résume l’ornithologue. Nous sommes au milieu du XXe siècle, et l’Aquitaine ne compte plus que de rares hivernantes.
« Mais, autour des années 1970, tout se goupille à merveille ! », se réjouit le bagueur de grues. L’espèce devient strictement protégée en Europe (1967 en France). L’industrialisation agricole, et surtout l’essor de la maïsiculture, profite aux grues. Enfin, des zones humides sont restaurées simultanément par plusieurs pays et ces oiseaux adaptables apprennent à utiliser de petites zones humides à proximité des habitations. « L’ancien site minier d’Arjuzanx a été réhabilité en réserve nationale de chasse et de faune sauvage dans les années 1980. Aujourd’hui, il accueille entre 25 000 et 30 000 hivernantes et migratrices de passage », estime le naturaliste. Cet éden de 2 500 ha s’ajoute aux quelques fiefs préservés de la région, dont le secteur de Captieux, un camp militaire qui a échappé à la domestication paysagère. Il n’est pas incongru d’imaginer qu’un jour des nicheuses pourraient se réinstaller dans les Landes. Plus au nord, l’étang de Cousseau rassemble toutes les conditions pour que ce scénario se concrétise. Si l’espèce est classée en préoccupation mineure sur la liste rouge à l’échelle européenne, elle reste quasi menacée en France en tant qu’hivernante – signe que des mesures de conservation doivent encore être prises.

S’acclimater à un monde toujours plus chaud
Le réchauffement climatique a de nombreuses conséquences sur la grue, en particulier dans les zones les plus méridionales. Le Maroc et ses zones humides comme Tahaddart pourrait un jour ne plus accueillir d’hivernantes en villégiature.
• Trajet migratoire raccourci, permettant de
s’épargner la Méditerranée, voire les Pyrénées.
• Hivernage plus au nord.
• Arrivée sur les sites de nidification les plus nordiques environ un mois plus tôt depuis 40 ans.
• Migration postnuptiale retardée, chez les populations d’Europe centrale, les sites d’alimentation étant plus longtemps épargnés par le gel/la neige.
• Évaporation accrue au cours de l’été autour des nids, exposant les couvées aux prédateurs.
• Assèchement de nombreux sites de nidification.
• Inondation des nids lors d’épisodes pluvieux extrêmes.
Reprendre ses quartiers sur la pointe des pieds
La dernière population nicheuse française se serait éteinte en Gascogne vers 1830. Mais la relève est là ! Avec le boom démographique, des immatures ont essaimé pour chercher de nouvelles zones propices. En France, la première famille a été fondée dans une région inattendue, la Normandie ! Le couple avait dévié du couloir habituel de migration et s’y est reproduit de 1985 à 1991. Puis, c’est la Lorraine qui a été adoptée dès 1995 pour ses lacs et étangs forestiers préservés, sous le regard réjoui d’Alain Salvi, président du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. « À l’heure actuelle, il y a sans doute une trentaine de couples », livre-t-il. Ce chiffre reste modeste, mais difficile à évaluer. « Les prospections sont souvent ingrates compte tenu de la discrétion des grues à ce moment de leur cycle. Tout indice est précieux, mais n’indique pas forcément une nidification réussie, témoigne le biologiste. 2020 affichait un joli bilan : sur sept familles suivies, trois ont élevé deux juvéniles, trois un seul et un couple aucun. Mais 2024 et ses pluies récurrentes a été calamiteuse pour les nids », conclut le spécialiste. Malgré ces fluctuations, la Woëvre à l’ouest et le Pays des étangs de Moselle à l’est pourraient encore voir leurs populations grandir.

Se tirer des dérangements
La grue rôtie, c’est fini depuis le milieu du XXe siècle en Europe. Mais l’espèce protégée reste par endroits une victime directe ou indirecte du fusil. Non loin de Vaasa, petite ville côtière finlandaise, la zone agricole de Söderfjärden offre ses résidus de récolte à plus de 15 000 grues chaque automne… mais n’est pas une réserve naturelle. « Les grues sont dérangées par les chasseurs d’oies, expliquent Tero Piikkilä, membre de l’association ornithologique de Vaasa, et Harry Seppälä, compteur d’oiseaux. Des coups de feu sont entendus tout au long de la journée et à la tombée de la nuit. Heureusement, ces dernières années, cette activité a diminué avec le vieillissement de la génération de chasseurs. » Mais une autre source de gêne a pris le relais : « Parfois, des curieux essaient de prendre des photos en marchant dans les champs près des oiseaux. La dernière mode est celle des drones, qui les effraient et les font voler inutilement, se désolent les ornithologues. Une de nos principales activités est d’informer le public, mais il n’est pas possible d’atteindre tout le monde. » Le reste de l’Europe n’est pas non plus épargné par l’engouement parfois fanatique pour cet oiseau. La période de reproduction est la plus sensible. Au moindre dérangement, les couples abandonnent leur nichée, alors à la merci des prédateurs. Pire encore, le braconnage est encore à déplorer, et même les vols d’œufs, des régions périurbaines allemandes aux terres reculées de Scandinavie. En plusieurs endroits, des bénévoles ou des gardes se relaient pour veiller nuit et jour sur les nichées.

Cohabiter avec les cités
Depuis cinquante ans, la grue cendrée vit un boom démographique marqué au nord-est de l’Allemagne après y avoir frôlé l’extinction. Avec la saturation des sites naturels, les nicheuses se sont rapprochées des agglomérations, tels le nord de Berlin ou la banlieue de Hambourg. Partout en Europe, elles doivent aussi s’adapter à des villes tentaculaires et des réseaux d’infrastructure toujours plus denses...
• Territoire rétréci, limité par les constructions et aires de loisirs (parfois 15 m entre deux nids).
• Accommodation à la présence humaine et réduction
de la distance de fuite (200 m).
• Succès reproductif diminué (concurrence alimentaire, défense territoriale accrue, perturbation des nids en raison de la proximité humaine).
• Perte de sites d’alimentation et de reproduction. La construction de parcs éoliens et solaires est par endroits même autorisée sur des sites naturels, comme en Allemagne.
• Principale cause de mortalité artificielle en Europe, par collision ou électrocution.
• Solutions : signalement (dispositifs colorés, éclairage UV), enfouissement des lignes.

Réinventer le voyage
La grue la plus célèbre de Suisse trône sur le drapeau de la Gruyère. Pourtant, aucune trace historique ne permet d’affirmer que l’oiseau était un hôte de cette contrée fribourgeoise fondée par Gruérius, un chef vandale dont le nom n’a peut-être qu’un vague lien avec l’échassier. Le pays montagneux a longtemps – si ce n’est toujours – été boudé par l’oiseau migrateur, mais la donne a changé : 2024 a même été une année exceptionnelle. « En début de migration, le 21 octobre, un groupe de 800 oiseaux a été signalé, un record. Le passage s’est un peu calmé par la suite », rapporte Chloé Pang, porte-parole de la Station ornithologique suisse. La nouvelle ère s’est amorcée en novembre 2011, où plusieurs milliers de voyageuses ont survolé le Plateau helvétique, probablement déportées par un courant d’est persistant. « Comme le trajet migratoire des grues n’est pas déterminé génétiquement, mais transmis par l’expérience et que cet itinéraire semble convenir aux grues, elles sont toujours plus nombreuses à passer par la Suisse », ajoute l’ornithologue.
Certaines de ces exploratrices font escale au Fanel, dans le Seeland ou encore dans la plaine de la Broye. La nuit, on peut même les entendre depuis les grandes villes comme Bâle ou Genève. Ces visiteuses font principalement partie des populations finlandaises, baltes, polonaises et russes occidentales qui rejoignent habituellement l’Afrique du Nord par la voie baltique-hongroise. Après leur repos en Hongrie, elles changent de cap vers l’ouest et contournent les Alpes par le nord (Autriche, Bavière, Suisse) ou par le sud (Italie). D’autres viennent directement de l’Allemagne. La majorité des baroudeuses stoppe en Camargue pour hiverner. Loin des voies de migrations historiques, le delta du Rhône avec sa mosaïque de zones humides et de rizières vit un essor spectaculaire depuis 2004. Il a accueilli 27 500 résidentes l’hiver dernier ! Les grues ont dû se passer le mot...

Survivre à la grippe
Maladie récente, l’influenza aviaire pourrait causer l’effondrement des populations européennes en quelques mois, si elle se propageait rapidement parmi les principales voies migratoires.
• 1996 : Détection d’une forme hautement pathogène de la grippe H5N1
dans des élevages intensifs de poulets en Chine.
• 2005 : Premiers cas sauvages chez les oiseaux d’eau.
• 2020 : Nouvelle souche virulente dans les populations sauvages.
• 2021 : Premier foyer chez la grue cendrée. † 8 000 à 10 000 ind. Décembre, vallée de la Houla en Israël (> photo ci-contre). Site rendu attractif depuis 1990 avec la culture d’arachides et des nourrissages artificiels quotidiens qui génèrent des concentrations très denses.
• † 2023 : 20 000 à 30 000 grues. Décembre, parc national d’Hortobágy
(Hongrie), durant le pic migratoire.
• † 2024 : 400 grues. Février, vallée de la Houla. Les fonds manquent pour ramasser les oiseaux infectés en raison de la guerre à Gaza.
• 2050 ? La restauration massive de zones humides et des alternatives à l’aviculture intensive limiteraient la concentration des oiseaux respectivement sauvages et domestiques, donc les foyers de contamination.
Manger à sa faim
Quand les hivernantes débarquent en Estrémadure, entre octobre et novembre, les céréales ont déjà été récoltées. « C’est dans les chaumes que les voyageuses affamées trouvent une nourriture abondante, facile d’accès et très visible », explique José Ángel Sánchez González, membre de l’association locale Grus Extremadura. Picorant les restes de riz, de maïs ou de blé, elles empêchent la repousse en saison froide et enrichissent le sol avec leurs excréments. Et tant qu’à faire, elles extraient des bulbes d’adventices et picorent des insectes indésirables.
La région attire foule de grues grâce à un paysage multiséculaire et endémique en déclin, la dehesa. Ces chênaies clairsemées accueillent des cultures céréalières extensives et des herbages où les cochons gambadent. « En décembre et janvier, les glands se détachent déjà des chênes et sont à la disposition des grues. C’est à cette époque qu’elles entrent en majorité dans les pâturages. Elles cherchent des creux dans le sol pour caler les glands, les ouvrir avec le bec et accéder au riche contenu. C’est beau de voir les jeunes accompagnés de leurs parents picorer maladroitement les glands qui volent dans les airs ! s’amuse le passionné. Comme les oiseaux entrent en compétition avec le bétail, le gouvernement propose des mesures compensatoires aux agriculteurs. Mais peu les demandent, car les dommages sont généralement mineurs et les grues sont souvent effarouchées à coups de canon », rapporte l’ornithologue.
Le paysage cultivé espagnol vit des mutations constantes en fonction des prix du marché. « Des zones céréalières ou des pâturages sont convertis en cultures arboricoles intensives, ce qui les rend impraticables pour cette espèce, se préoccupe le spécialiste. En 2022, Grus Extremadura a porté au tribunal la transformation d’une dehesa protégée en oliveraie super-intensive et a eu gain de cause. Pourtant, la polyculture d’origine n’est toujours pas reconstituée. »
Partout en Europe, la présence de ces oiseaux dans les grandes cultures suscite localement des tensions. Car ils ne font pas que consommer des restes, il leur arrive de faire des razzia automnales de céréales mûres et de patates ou de piétiner et recouvrir de fientes des prairies de fauche... Un nouveau problème est signalé au printemps : les machines de dernière génération ne laissent aucun résidu après récolte et détournent les affamées vers les champs fraîchement semés. Des solutions existent : les indemnisations, le maintien de chaumes tardifs ou encore les sites artificiels de nourrissage comme la Ferme aux Grues en Champagne, dont le tourisme profite à l’économie locale.

Inspirer la paix
La résilience des grues est mise à mal chaque fois qu’un site de rassemblement disparaît. Dès le premier jour de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, la réserve naturelle d’Askania Nova au sud du pays a été occupée par les troupes russes. Ce dernier vestige de la steppe originelle qui couvrait une grande partie de l’est de l’Europe attirait les grues en migration. « Plus d’un cinquième des 33 000 ha de réserve a été détruit par des incendies. Les vols constants d’avions militaires à basse altitude stressent la faune. Beaucoup d’animaux ont été déplacés ou tués, mais il est difficile de mener des recherches sur le terrain, constate Petro Gorlov, qui étudie cet oiseau en Ukraine depuis trente-trois ans. La guerre a aussi eu des conséquences sur la nidification, au nord du pays. » Une population a cessé d’exister dans une forêt sinistrée par les combats. Au nord-ouest, les hostilités ont commencé pile au moment de la saison de reproduction en 2022. « Les territoires de Jytomyr et Rivne, qui abritaient les plus grandes populations nicheuses, ont été bombardés. La situation actuelle n’est pas connue », glisse l’ornithologue réfugié. Chère grue, toi qui fais société en bonne intelligence, et qui es si sensible à la santé des milieux, inspire-nous à construire enfin un monde pacifique, où coulent des rivières libres et renaissent les marais !

Le saviez-vous ?
Environ 800 000 : Effectifs mondiaux de la grue cendrée, dont plus de 400 000 en Europe (le reste en Asie). Stables après une forte progression ces cinquante dernières années.
2 à 4 ans : Âge des premières tentatives d’accouplement. La pérennité des populations de grue cendrées repose sur la survie des adultes, qui élèvent au maximum deux jeunes par année, tardivement matures.
Environ 25 ans : Longévité à l’état sauvage (42 ans en captivité). Elle peut donner l’apparence trompeuse d’une population stable, mais il faut un nombre suffisant de jeunes chaque année pour assurer la relève à long terme.
Cet article fait partie du dossier
L’appel des grues
-
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciL’aube avec les grues au lac du Der
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciPas encore de V de la victoire pour les grues
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciLes 15 espèces de grues dans le monde
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici3 choses à savoir sur les grues cendrées
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciLa grue « danse pour faire société… comme nous ! »
Abonnés -
 Dossiers
Dossiers
Dossiers
DossiersDu nid au ciel, les premiers mois périlleux des bébés grues
Abonnés -
 Julien Perrot
Julien Perrot
Julien Perrot
Julien PerrotMerci les voyageuses

Cet article est extrait de la Revue Salamandre
Catégorie
Ces produits pourraient vous intéresser
Poursuivez votre découverte
La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille
Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous
Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature
Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique
merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur