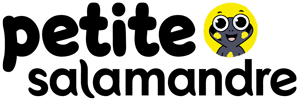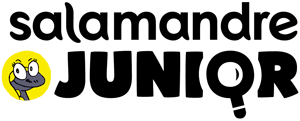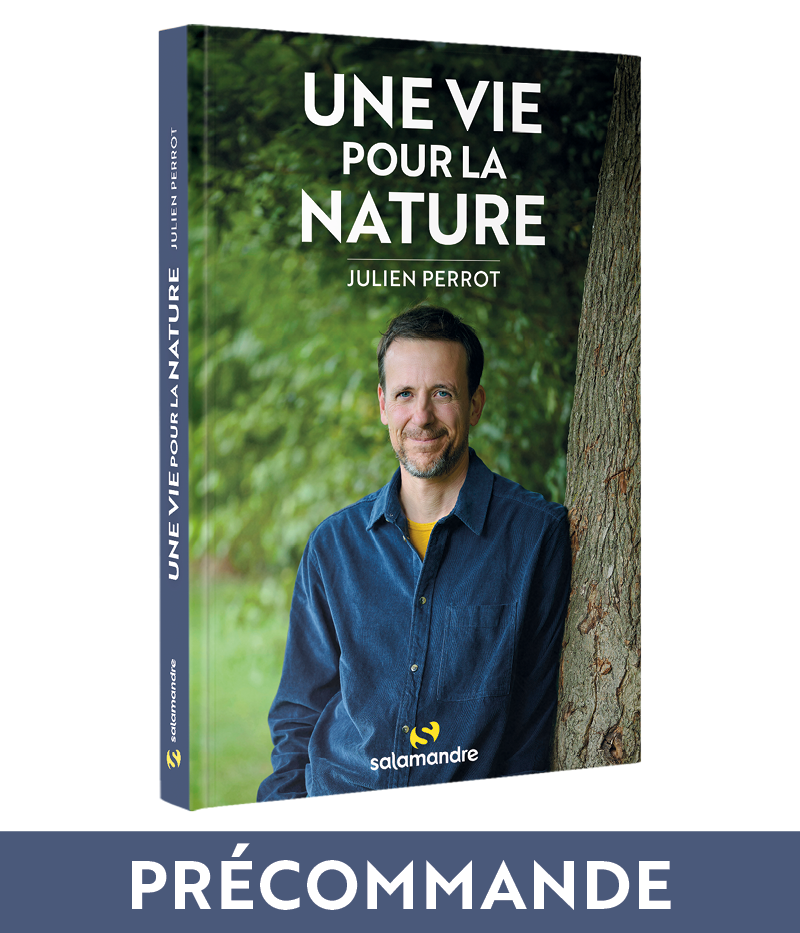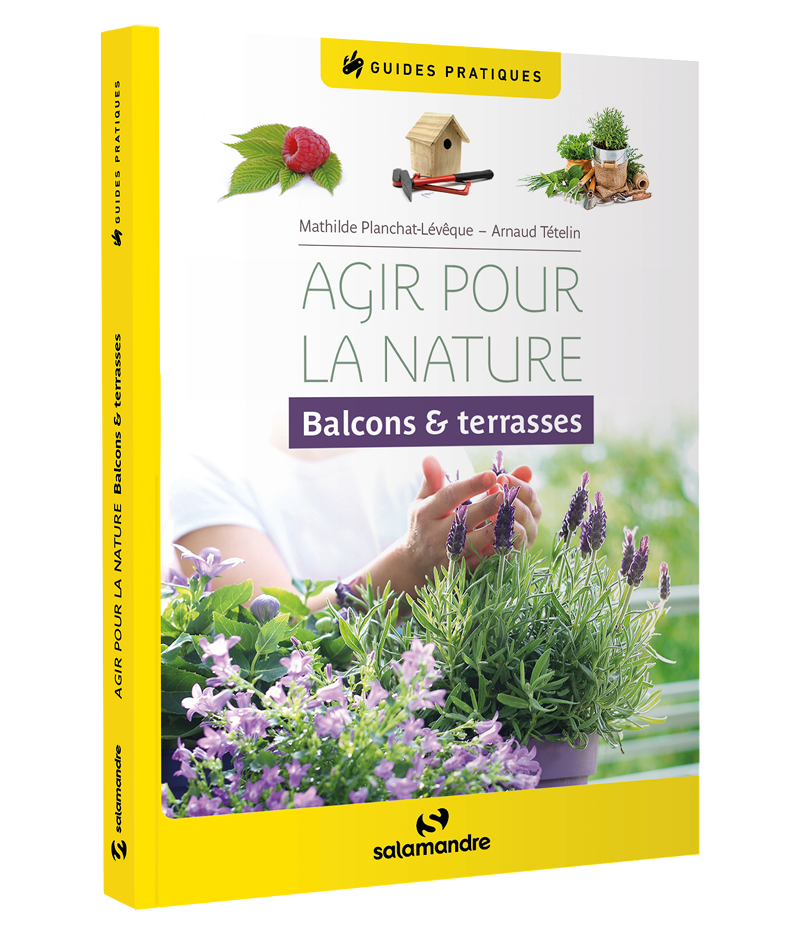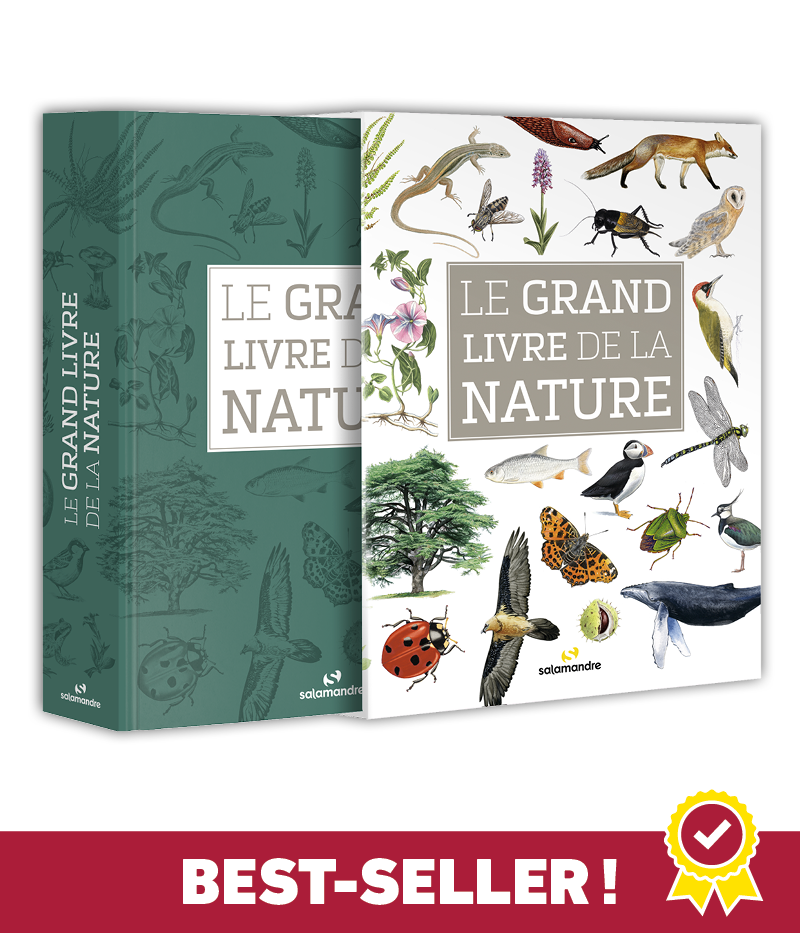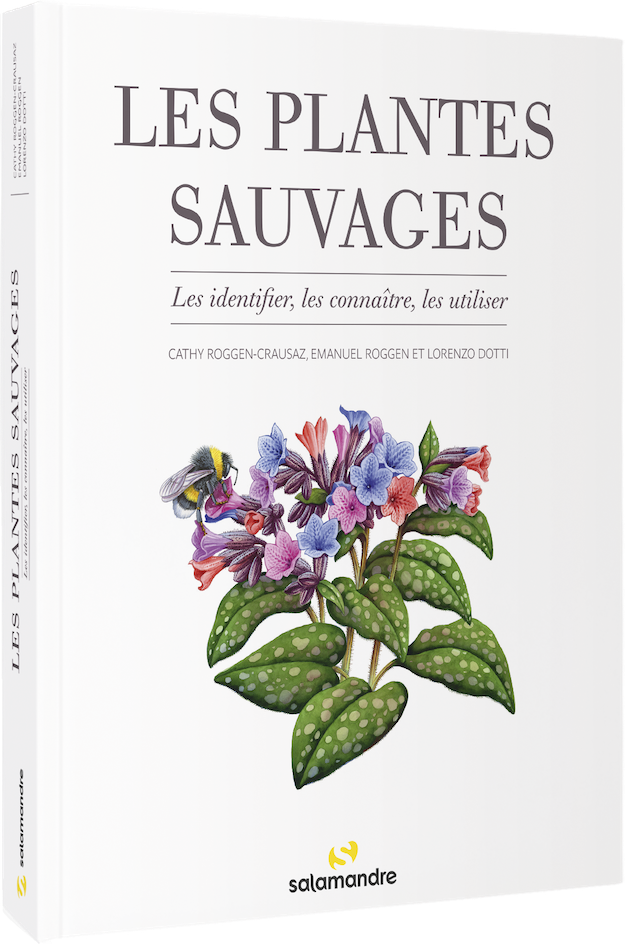Du nid au ciel, les premiers mois périlleux des bébés grues
Entre deux voyages, à quoi ressemble le quotidien de l’oiseau gris ? Suivons un couple qui se lance dans une aventure de haut vol : fonder une famille.
Entre deux voyages, à quoi ressemble le quotidien de l’oiseau gris ? Suivons un couple qui se lance dans une aventure de haut vol : fonder une famille.
Air : Quel effort ! Un peloton de 200 voyageuses dévore les kilomètres d’un vol soutenu, oscillant entre 45 et 65 km/h. À l’arrière de la formation, une femelle de 6 ans n’a qu’une idée en tête ce mois de février : arriver le plus vite possible sur les lieux de reproduction au nord. La saison sera courte et il faut s’assurer une bonne place. Vingt-quatre heures et 1 500 km après la Champagne, le groupe arrive au lac Hornborga en Suède. Ses rives sont encore figées par la glace, mais les hormones qui affluent dans le sang de la jeune grue ne trompent pas, ce signal est calé sur l’allongement de la durée du jour.
Terre : Sur ce haut lieu de rassemblement, d’autres oiseaux arrivent par vagues dans une belle cacophonie. C’est le temps des danses. Répétées toute l’année, elles sont cette fois-ci plus intenses. Une voisine se met à courir, stoppe net, puis fait des bonds élastiques, ailes déployées et pattes virevoltant en tous sens. L’excitation est contagieuse et le ballet nuptial se propage, accompagné de quelques prises de bec. Au milieu de la foule, la magie opère : la tête relevée, un mâle grogne et tourne lentement autour de la femelle. Oui, elles se souviennent de l’an passé, elles ont envie de recommencer ! Ainsi se font ou se refont les couples. Entre février et mars, le collectif se dissout, les paires rejoignent leur territoire habituel ou cherchent un nouveau coin.

Eau : Leur refuge nuptial compte 50 à 500 ha, selon la disponibilité en ressources. Forêts inondées, rives marécageuses ou tourbières ponctuées de saules et de bouleaux… ces lieux répondent à une exigence immuable : la présence d’eau libre tout au long de l’été afin de protéger le nid. Après un premier repérage effectué dans le marécage qui leur est familier, nos deux grues défendent âprement leurs terres pour éviter la concurrence alimentaire. Si les cris et postures démonstratives ne suffisent pas à chasser un congénère sans gêne, ils en viennent aux pattes et au bec. Une fois les limites entendues entre voisins, elles ne sont plus contestées. Le code moral, ici, on le respecte !
Feu : Brûlants de passion, les tourtereaux dansent fréquemment. Pendant ces agitations ou durant les périodes plus calmes, ils émettent un chant en duo – unison call en anglais. Cou tendu vers l’arrière, bec pointé au ciel, la femelle et le mâle se déplacent lentement côte à côte en émettant une séquence de sons intercalés de manière coordonnée. À force de répétitions, le duo devient parfaitement synchronisé, une manière de souligner son union et d’affirmer son territoire. Un matin, la femelle se montre réceptive aux gesticulations de son partenaire. Il peut monter à califourchon sur son dos, battant des ailes pour ne pas tomber. Cet accouplement sera suivi des jours durant par d’autres, toujours plus fiévreux.

Élever
Le printemps débarque et un petit miracle grandit dans le ventre de la femelle. Mille découvertes attendent déjà l’oisillon dans le grand marais.
Paille : Le comportement des grues change radicalement. Il faut maintenant incarner la discrétion… hormis quelques échauffements de voix au réveil. Au programme, bâtir le nid. Le chantier durera cinq jours à trois semaines. D’abord, choisir d’un commun accord un emplacement secret, les pieds dans l’eau. Ensuite, ramasser des brindilles ou cueillir des roseaux, joncs et autres herbes aquatiques. Puis les jeter derrière son dos en visant approximativement la zone envisagée du berceau. Enfin, rassembler le tas pour constituer une plate-forme de 1 m de diamètre environ, dépassant de 10 à 20 cm la surface de l’eau. Tada !
Rouille : Avril. Les partenaires acquièrent des reflets bruns par des colorations successives. Leur salon de coiffure ? Une zone de boue enrichie en pigments d’oxydes de fer. Chaque oiseau y prélève la terre brun-rouge avec son bec et l’étale sur son dos durant de longues minutes. Le camouflage au nid est parfait dans le paysage marécageux encore brunâtre. Justement, un bel œuf tacheté est apparu sur la plateforme. Puis un deuxième, deux jours plus tard. Les partenaires vont se relayer à égalité durant un mois environ pour couver leur trésor. L’astreinte dure en général une à deux heures avant la prochaine rotation pour se dégourdir les pattes et s’alimenter. En cas de danger, l’autre est averti ou appelé en renfort par des « Pöööt » insistants.
Calcaire : Début mai. Un trille étouffé filtre à travers la coquille. C’est le tout premier son d’un petit être cherchant le contact avec ses parents. Sous leur regard nerveux, l’œuf surprise se fissure. Un œil rond brille parmi le duvet brun doré. Déjà alerte, le poussin d’à peine 15 cm de haut se blottit contre le parent qui s’est remis à couver le deuxième œuf. Mais ce dernier restera silencieux. La loterie de la vie… D’ailleurs, une fois éclos, ce n’est pas encore gagné : les chances de survie les premiers mois sont de 50 %, car les petits sont des repas faciles et appétissants.
Plume : Vingt-quatre heures après l’éclosion, le poussin plumé explore déjà les alentours du haut de ses pattes vacillantes. Bientôt, cet oisillon déjà émancipé du nid, qu’on qualifie de nidifuge, suit ses parents à la nage ou à pied dans les marais et prairies alentour. Pour bien grandir, ses premières becquées sont protéinées. Progressivement, le gruau apprend à reconnaître et attraper ce qui est comestible : bestioles à six ou huit pattes, vers, gastéropodes, un peu plus tard amphibiens, reptiles, micromammifères ou parfois petits poissons. Les excursions sont toujours plus longues sur les tapis de mousse ou dans les hautes herbes. Les végétaux sont progressivement intégrés au menu : jeunes pousses de roseau, bulbes, baies… et le jeune grandit à vue d’œil.

S'élever
Élan : Dans une clairière nordique inondée par le soleil d’août, le couple de grues semble danser de joie. Bientôt, son jeune de 10 semaines se joint à la fête en les imitant maladroitement. Quelques minutes auparavant, il a réussi son premier long vol ! La famille est prête à rejoindre des lieux distants de plusieurs kilomètres où ont déjà commencé à se regrouper les individus non nicheurs. Partout, l’effervescence gagne à nouveau le peuple cendré. Voici venu l’appel du sud et des grands rassemblements, d’où naîtront des vagues successives de migratrices.
Dialogue : Fin septembre, sur l’île de Rügen, dans la mer Baltique, des dizaines de milliers d’oiseaux se parlent inlassablement. Le jeune affûte son catalogue de vocalisations pour exprimer une large palette d’informations : alarme, coordination du décollage, émotions... De plus, chaque grue possède une signature vocale unique pour être reconnue individuellement. Leur langage cache encore bien des mystères, mais une chose est sûre : il leur permet de déployer une vie sociale complexe.
Culture : Un matin d’octobre, par beau temps et vent arrière, la famille s’élance avec une cinquantaine de congénères, cap sud-ouest. La migration automnale est moins pressée, entrecoupée de plus longues haltes, et s’étale sur quatre à cinq mois pour l’ensemble de la population. Les grues s’orientent grâce aux astres, au champ magnétique terrestre et aux paysages. Mais les repères probablement les plus déterminants sont les congénères. Guidé par ses parents, le juvénile apprend et mémorise sa première route et ses escales. Plus tard, il en découvrira d’autres en suivant un groupe différent. Chez les grues, on parle d’une culture de la migration, où l’expérience des unes est bénéfique aux autres et où les savoirs évolutifs se transmettent et s’ajustent de génération en génération.
Métissage : En cours de route, de l’Allemagne à l’Espagne, de petits groupes quittent progressivement le cortège pour s’installer en hivernage. Le petit dernier va vivre son premier hiver avec ses parents dans la vaste lagune de Gallocanta, au nord-est de l’Espagne. Puis, il volera de ses propres ailes entre janvier et mars, pour vivre en bandes avec d’autres immatures. Leurs explorations ouvriront la voie à des découvertes territoriales ou à la rencontre d’autres populations. Le comportement migratoire de Grus grus est très flexible. Certains individus changent complètement d’itinéraire d’une année à l’autre, voire entre l’aller et le retour. Les analyses génétiques révèlent qu’au pays des grues, qui ne connaît pas les frontières, les échanges sont fréquents sur toute l’aire de répartition, de l’Europe occidentale à la Russie. Aidées par leur intelligence collective et leur adaptabilité, les nouvelles générations mettent toutes les chances de leur côté pour surmonter les obstacles qui les attendent en chemin.
6 faits fascinants à connaître sur les grues cendrées
Relations libres : Fidèles jusqu’à ce que la mort les sépare ? Selon de récentes observations, les relations amoureuses des grues sont bien plus mouvantes qu’on ne l’imaginait. Oui, certains couples sont stables sur plus de dix ans, et on a rapporté des observations touchantes d’oiseaux veufs apathiques ou cherchant désespérément leur moitié. Mais plus de la moitié n’hésitent pas à changer de partenaire au moins une fois dans leur vie, surtout face à des échecs de reproduction. Des ex peuvent même se remettre ensemble après une séparation ou choisir de vivre en bon voisinage avec leurs nouvelles relations respectives.

Garde rapprochée : Lors des excursions hors du nid, si les poussins sont deux, chaque parent en prend un sous son aile. Qu’un sanglier, renard, mustélidé ou corvidé se pointe, il sera chassé à coups de bec et de pattes par l’adulte. Mais en grandissant, les explorateurs deviennent imprudents et peuvent rapidement échapper à la surveillance parentale. En atteignant la taille adulte, les seules vraies menaces naturelles resteront les aigles. Contre eux, la devise « Ensemble, on est plus fortes ! » s’applique. Même durant la saison territoriale, si un tel danger est repéré, les couples alertés se déplacent pour former un groupe soudé. Leurs cris et becs pointés tels des fers de lance finissent par dissuader le rapace.
Peau rouge : Telle une geisha, la grue cendrée semble maquillée de coups de pinceau noir et blanc sur la tête et le cou, avec une petite touche carmin au sommet du crâne. Cette marque colorée est en fait une zone de peau dégarnie de plumes où les vaisseaux sanguins affleurent en nombre. Nullement affolante, cette calvitie serait même séduisante. Elle vire au rouge vif durant la période de reproduction, et particulièrement quand l’animal est excité. Les femelles et les mâles sont très semblables, mais cette tache au niveau de la calotte est un peu plus grande chez ces derniers, tout comme leur panache de plumes arrière et leurs mensurations…
Trompette intégrée : Si les grues ont tant de coffre, c’est que leur corps renferme un instrument qui serait, une fois déroulé, aussi long que leur propre taille ! Pouvant atteindre 130 cm, la trachée est enroulée en double boucle dans le sternum qui prend la forme d’un boîtier creux. Ce dispositif vibre à diverses fréquences selon le travail des muscles de la syrinx, l’organe vocal. Cette trompette engoncée dans un tambour peut porter à plus de 2 km de distance. Elle se développe à mesure de la croissance du gruau. Voilà pourquoi il n’émet les premiers mois que de faibles sons enroués.
Panache farceur : Quelle fière allure ont les élégantes créatures lorsqu’elles pavanent avec leur magnifique queue. Queue, dites-vous ? En réalité, ce qui ressemble à la traîne d’un coq est formé par les plumes des ailes proches du corps, les rémiges tertiaires. Bouffantes et retombantes au repos, elles cachent la vraie queue, bien plus courte.
Saute-mouton : Qui soupçonne ce qui se joue au-dessus de nos têtes ? Généralement, plus une grue niche au nord, plus elle va hiverner au sud. Autrement dit, les routes migratoires des populations les plus nordiques enjambent celles, plus courtes, de leurs congénères des zones plus tempérées. On parle de migration en saute-mouton. De plus, l’espèce est un migrateur partiel : une population est sédentaire en Turquie, d’autres tendent à se sédentariser en Allemagne lors d’hivers cléments.
Écoutez les chants des grues cendrées
Cet article fait partie du dossier
L’appel des grues
-
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciL’aube avec les grues au lac du Der
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciPas encore de V de la victoire pour les grues
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciLes 15 espèces de grues dans le monde
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici3 choses à savoir sur les grues cendrées
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciLa grue « danse pour faire société… comme nous ! »
Abonnés -
 Dossiers
Dossiers
Dossiers
DossiersDu nid au ciel, les premiers mois périlleux des bébés grues
Abonnés -
 Julien Perrot
Julien Perrot
Julien Perrot
Julien PerrotMerci les voyageuses

Cet article est extrait de la Revue Salamandre
Catégorie
Ces produits pourraient vous intéresser
Poursuivez votre découverte
La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille
Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous
Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature
Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique
merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur