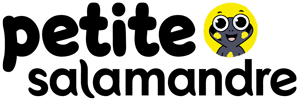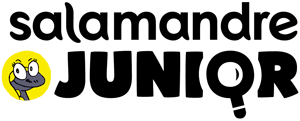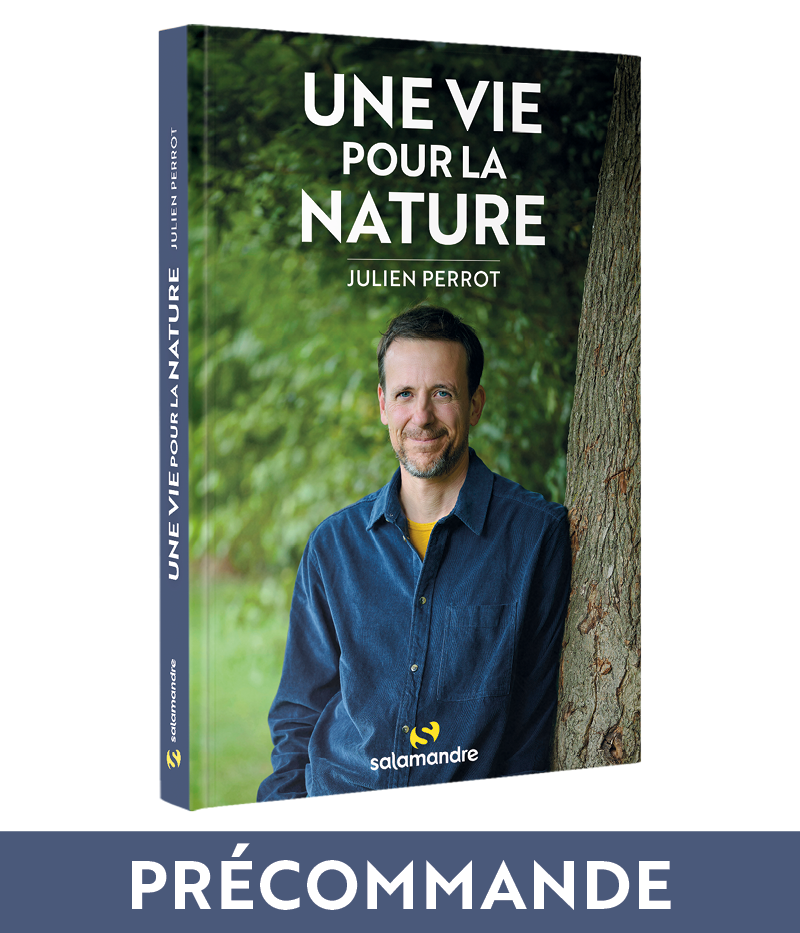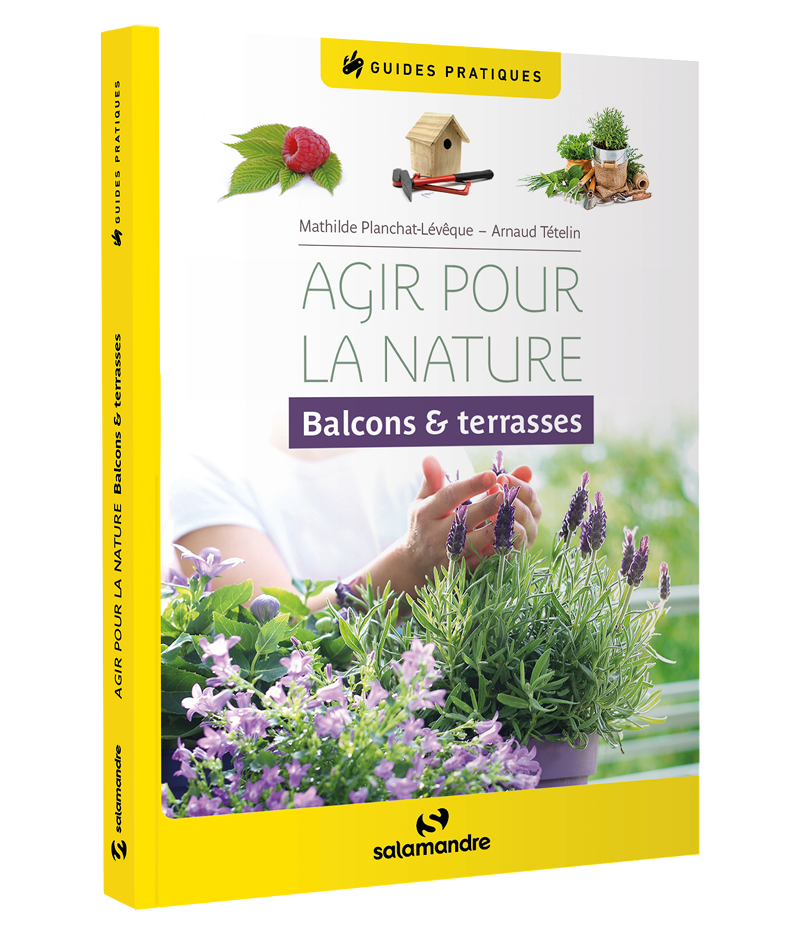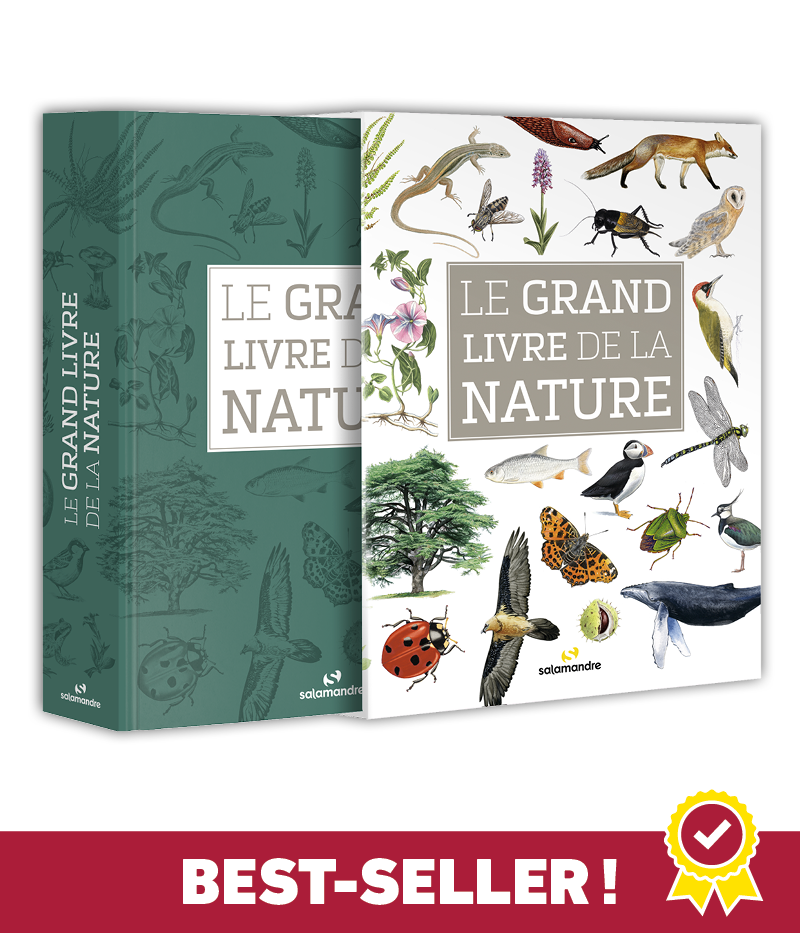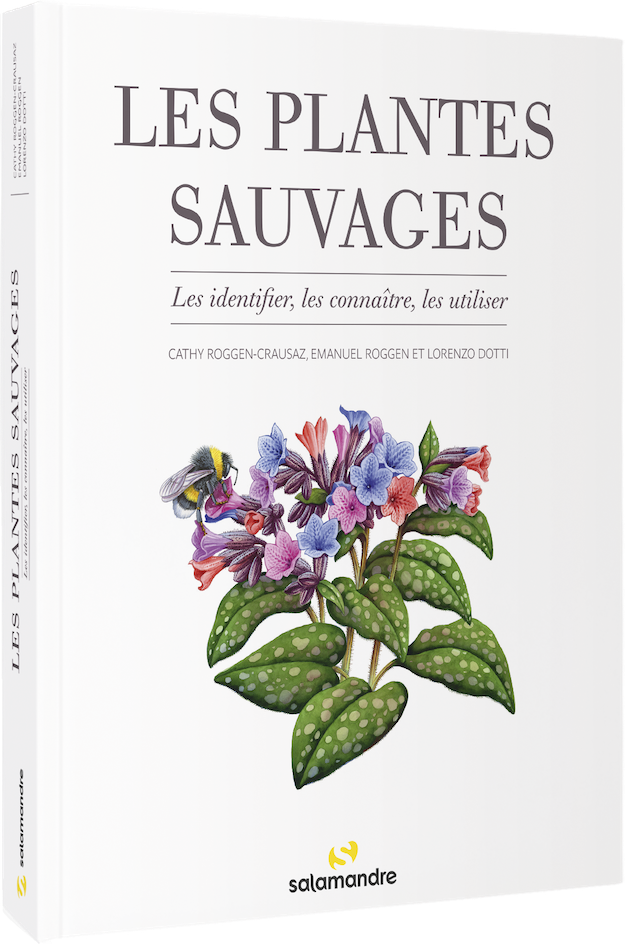Retour de flammes pastorales
Au sein des montagnes pyrénéennes, Margaux Rebours photographie le visage des estives après l’écobuage. Une pratique agricole ancestrale qui bouleverse le paysage.
Au sein des montagnes pyrénéennes, Margaux Rebours photographie le visage des estives après l’écobuage. Une pratique agricole ancestrale qui bouleverse le paysage.

Inspirée par le sauvage et émerveillée par les liens entre les êtres vivants, Margaux est photographe dans l’ouest de la France. Elle aime également accompagner ses images de textes poétiques. Son site : reboursmargaux.com
Chaque année, en hiver, de lointaines lumières semblent danser sur les montagnes pyrénéennes à la tombée de la nuit. Un matin, suite à l’observation de ce spectacle intriguant, me voilà partie en vagabondage dans la vallée d’Aspe. Jumelles en main, je scrute l’horizon dans l’espoir d’apercevoir le vol bien caractéristique de ces rapaces à l’envergure démesurée, qui me fascinent tant. Du vautour fauve au percnoptère d’Égypte en passant par le gypaète barbu, tous veillent sur leur territoire avec grande attention. Mes yeux s’accrochent aux diverses matières qui composent les lieux. Je suis sensible aux enchevêtrements des végétaux dans la roche et à la valse des ombres qui les met en lumière. Je me plonge dans la beauté de ces paysages et dans la perspective d’une rencontre animale. Le temps est particulièrement calme, seul le cri reculé d’un milan se fait entendre. La faune sauvage semble avoir déserté les parages. Ce vide attise ma curiosité et me pousse à continuer mon chemin. Il ne me faut pas longtemps pour trouver le sujet de mes questionnements.

Les palpitations de mon cœur se font de plus en plus intenses, je ressens une chaleur ambiante se refléter sur les roches environnantes, tandis que mon corps crispé commence à deviner des effluves irritants. L’horizon se gorge d’une atmosphère inhabituelle : les feux pastoraux, aussi appelés écobuages, sont en action pour redessiner les alpages. Accroché aux cimes, un panache de fumée esquisse un tableau dévastateur.

Les flammes carminées dansent parmi la végétation, ne laissant derrière elles que la seule trace d’une ombre. Elles provoquent un grondement incessant qui résonne aux creux des rivières ou sur les pans rocheux, de quoi faire pâlir de jalousie les orages les plus sensationnels. La main de l’homme embrase les montagnes. Les flammes dévalent les pentes et absorbent avec elles l’air printanier. Dans ce paysage devenu charbonneux, il règne désormais une sombre mélancolie.
L’odeur de brûlé envahit peu à peu l’air ambiant. Elle apporte une pluie de cendres qui s’abat dans la vallée au gré du vent. Les habitants alentour barricadent leurs fenêtres pour tenter d’échapper à cette poussière grisâtre et aux particules tombant de part et d’autre. Les locaux le savent, durant ces pratiques d’écobuage, la qualité de l’air devient nocive pour la santé.
L’absence d’animaux devient tristement compréhensible. Tentent-ils d’échapper à ce spectacle ? Sont-ils déjà fossilisés quelque part dans ce brasier ? Les questions fusent, les prairies habituellement riches de vie sont désormais noir et blanc. Faune et flore ont été effacées comme craie au tableau, afin de créer une nouvelle page où la résilience sera de mise.

Le saviez-vous ?
Place nette
L’écobuage est une pratique ancienne qui consiste à débroussailler par le feu les pâturages d’estive. Ce procédé efficace et peu coûteux permet de réduire la quantité de certains végétaux comme les fougères, ce qui contribue au maintien du développement d’une herbe fourragère de qualité. Autrefois, de petites parcelles brûlaient, puis les cendres étaient dispersées pour fertiliser les sols. De nos jours, il y a moins d’agriculteurs, mais sur de plus grandes surfaces. Les zones calcinées sont alors plus conséquentes, malgré les nombreux risques que cela comporte pour la santé humaine et la faune qui ne parvient pas toujours à fuir. La pratique est interdite ou encadrée selon les pays, les régions ou encore les saisons.
Un équilibre délicat
De nombreuses études ont montré que les incendies favorisent la diversité des espèces végétales. Mais ce phénomène n’a pas que du bon. La petite faune des larves, insectes ou araignées ne peut pas fuir. La perdrix grise des Pyrénées est un oiseau de montagne qui affectionne les landes à genêts.
À court terme, ces feux peuvent empêcher le développement de ces arbrisseaux s’ils ne sont pas assez espacés dans le temps (entre cinq et huit ans). À long terme, les brûlages et la gestion pastorale qui les accompagne retardent l’évolution naturelle des landes vers des stades forestiers, et sont donc synonymes de persistance des milieux semi-ouverts plutôt favorables à la perdrix grise. Une solution de gestion serait donc de préserver une mosaïque d’habitats différents, et d’exclure les feux dans certaines zones.


Cet article est extrait de la Revue Salamandre
Catégorie
Ces produits pourraient vous intéresser
Poursuivez votre découverte
La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille
Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous
Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature
Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique
merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur