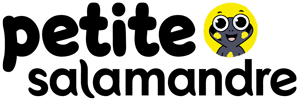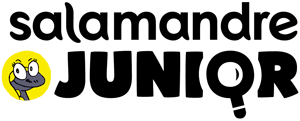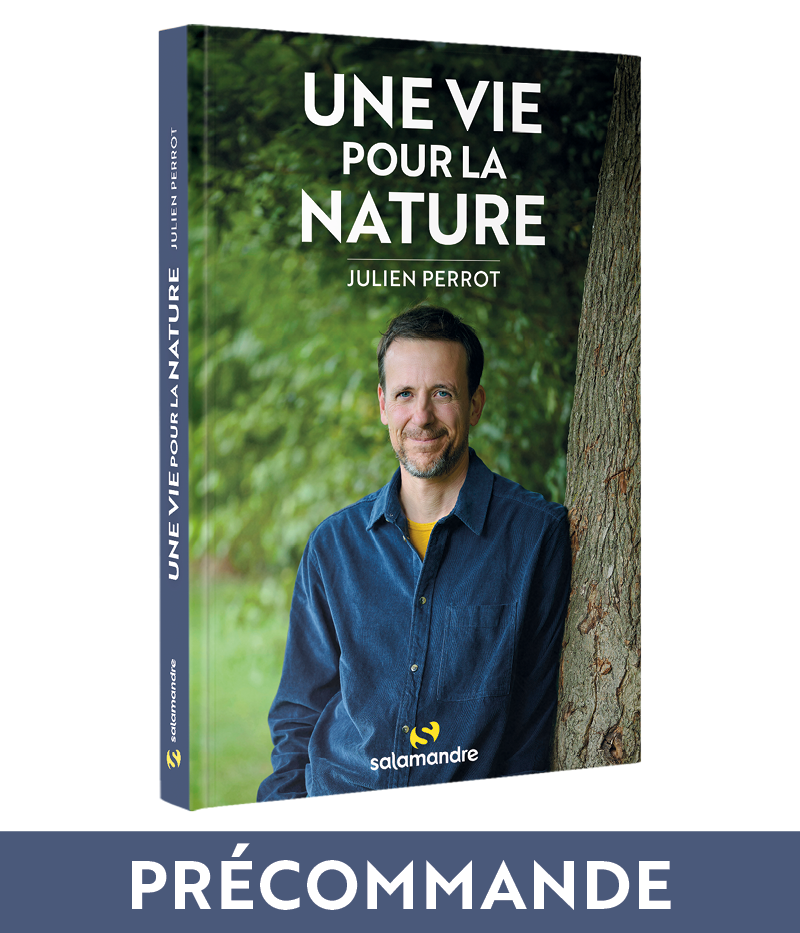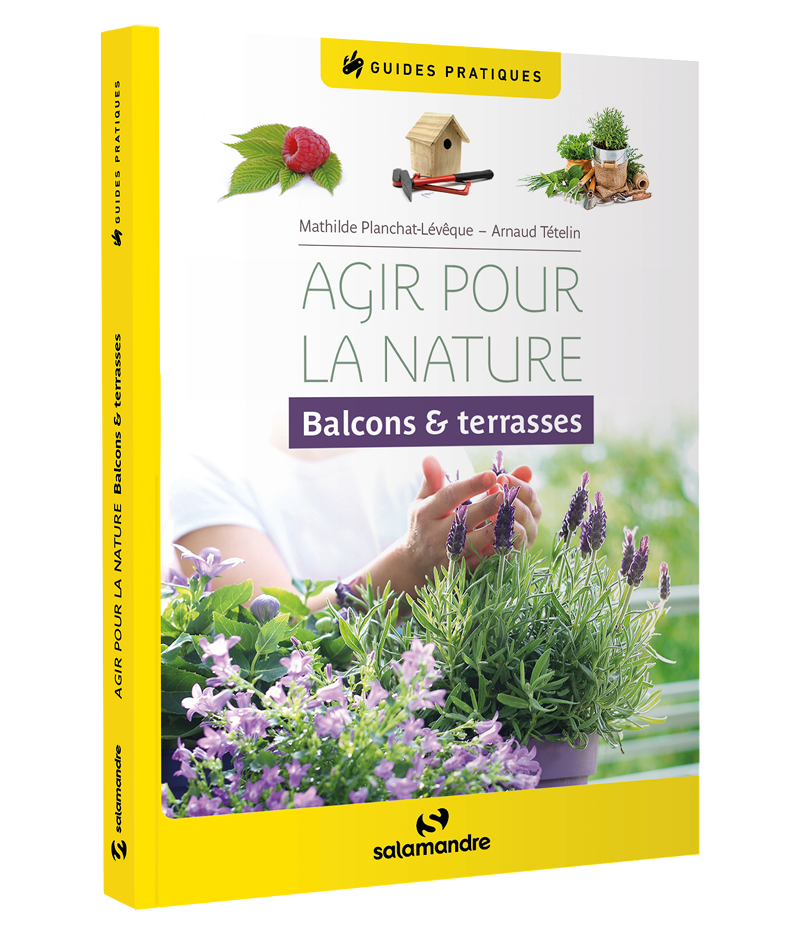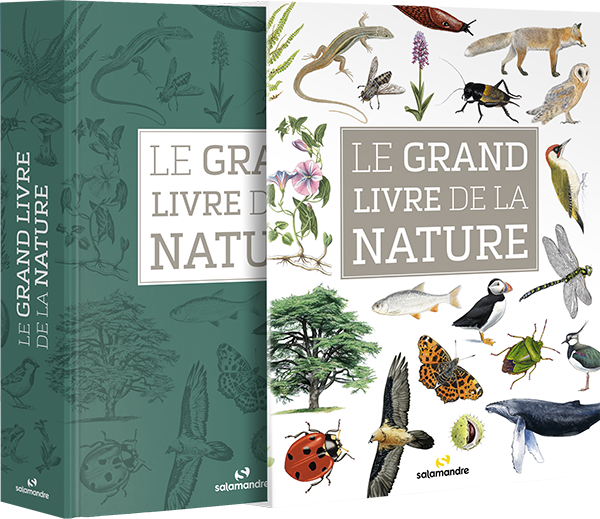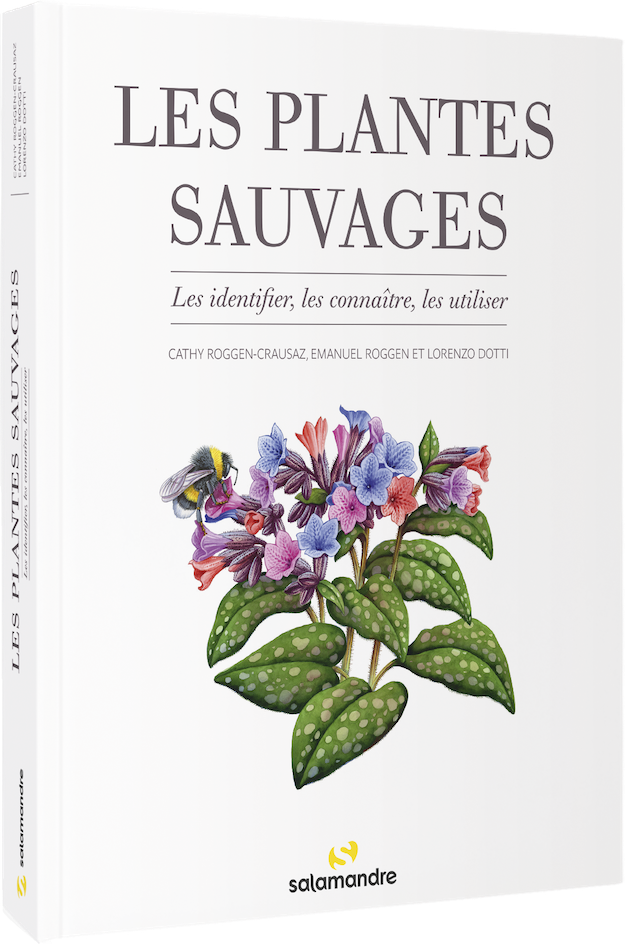Charlène Descollonges: «Il faut ralentir le cycle de l’eau»
Les chemins de l’eau sont de plus en plus fous et imprévisibles. Comment le vivant peut-il continuer à capter cette ressource vitale dont le cycle s’emballe ? Les réponses de l’hydrologue engagée Charlène Descollonges.
Les chemins de l’eau sont de plus en plus fous et imprévisibles. Comment le vivant peut-il continuer à capter cette ressource vitale dont le cycle s’emballe ? Les réponses de l’hydrologue engagée Charlène Descollonges.

Charlène Descollonges est ingénieure hydrologue, consultante, conférencière et autrice. Elle a co-fondé l’association Pour une hydrologie régénérative.
D’où vous vient cette passion pour l’eau ?
Enfant, je suivais mon frère qui pêchait à la mouche. J’ai toujours été sensible à la protection des rivières. J’ai rencontré l’hydrologie dès mes premières années d’études, qui m’ont conduite à travailler, en tant qu’ingénieure territoriale, dans la gestion locale de l’eau, les sécheresses, et la question du partage du précieux liquide entre humains et avec le vivant.
Comment définiriez-vous le cycle de l’eau ?
Classiquement, on imagine le cycle de l’eau comme une grande boucle entre l’océan et les continents. Mais les dernières études scientifiques montrent qu’il existe plusieurs cycles. L’eau qui s’évapore des océans retombe à 90 % sur ces étendues marines. Quand elle arrive sur les continents, elle transite par les vents dominants, mais ce sont les végétaux qui vont la retenir et provoquer de nouvelles pluies. Le végétal attire les masses d’air humide, il capte l’eau et la réinjecte dans l’atmosphère par évapotranspiration. En même temps, il émet des microparticules – spores, pollen, poussières... – servant de noyaux de condensation qui permettent à l’eau de tomber en pluie.
> Lire aussi : Cycle de l'eau, comment la pluie se forme-t-elle ?
C’est ce qu’on appelle le flux d’eau verte, qui transite par les plantes. Environ deux tiers des précipitations continentales proviennent de ce phénomène lié aux écosystèmes vivants. On est donc loin d’un cycle de l’eau régi uniquement par des lois physiques : le vivant joue un rôle majeur! En parallèle, l’eau dite bleue s’écoule dans les rivières, les lacs et les nappes. Une fois la pluie tombée, soit elle s’infiltre dans les sols, soit elle ruisselle vers la mer, via l’ensemble du réseau hydrographique, du petit ruisselet au fleuve, qui s’écoule au sein d’un bassin versant.

Ce cycle naturel de l’eau est aujourd’hui perturbé par les activités humaines...
Plus le milieu est artificialisé, plus l’eau va ruisseler rapidement au lieu de s’infiltrer. La majeure partie des impacts touche les flux d’eau verte, liés au végétal, en raison des changements d’usage des sols : déforestation, urbanisation, constructions de routes… L’agriculture intensive crée en outre une croûte compacte dite de battance qui empêche l’infiltration, à l’inverse d’une prairie naturelle. Des sols à nu vont ruisseler davantage et s’éroder. Cela dans un contexte où l’on a détruit une grande partie des zones humides ainsi que d’innombrables kilomètres de haies qui faisaient office de tampons ou de freins naturels.
> Lire aussi : Notre infographie sur comment les barrages cassent la boucle du vivant
L’accélération des flux d’eau bleue est quant à elle due aux aménagements hydrauliques : endiguement, rectification et creusement des rivières. Pour toutes ces raisons, les aquifères – nappes phréatiques – se rechargent moins bien. En même temps, on surexploite cette eau souterraine, parfois très profonde, pour l’irrigation et l’eau potable.
Quel rôle joue le changement climatique ?
Le réchauffement modifie le régime et la répartition des précipitations, avec des sécheresses plus fréquentes, plus longues et plus intenses, et des pluies extrêmes, sur des périodes plus courtes. Il intensifie ces phénomènes, et accélère encore le cycle de l’eau. On note aussi plus d’évaporation et une demande des végétaux de plus en plus précoce. Ces derniers réactivent leur photosynthèse et pompent de l’eau dès février ou mars sous nos latitudes, raccourcissant encore la période de recharge des nappes.
Derrière le cycle de l’eau, c’est aussi la biodiversité des milieux aquatiques qui s’effondre…
La disparition des zones humides, la fragmentation des milieux, les assecs, les retenues, les barrages… Tous ces aménagements ont des impacts énormes sur les espèces vivant en eau douce. La biodiversité aquatique continentale chute très fortement, plus vite que la biodiversité marine. Certaines espèces sont aussi affectées par le changement climatique qui réchauffe les biotopes : des poissons pourront migrer, d’autres ne résisteront pas. Sans compter la concurrence des espèces exotiques envahissantes, de plus en plus présentes.

Zones humides en danger
Marais, tourbières, prairies humides... Depuis 1900, près de deux tiers des zones humides de la planète ont disparu. En cause : l’agriculture intensive, les drainages et prélèvements d’eau, l’urbanisation, l’aménagement des cours d’eau, les espèces exotiques envahissantes, ou encore le contrôle des inondations et la destruction des marais insalubres. Les zones humides abritent pourtant une riche biodiversité, et rendent divers services : stockage et épuration de l’eau, stockage du carbone, prévention des crues, fraîcheur...
Que faire pour restaurer ce cycle de l’eau ?
Dans les paysages agricoles, le fil directeur est d’aller à rebours du remembrement, qui a déstructuré et homogénéisé les paysages. Il faut tout faire pour ralentir le flux et stocker l’eau dans la végétation et les sols. C’est le principe de l’hydrologie régénérative. Dans cette vision, on s’intéresse au cheminement des flux aquatiques. L’idée est d’avoir une lecture topographique du paysage, pour mieux répartir et ralentir les écoulements, en créant des fossés, des buttes, des haies, sur des courbes de niveau perpendiculaires à la pente. Les linéaires arborés permettent aussi à l’eau de mieux s’infiltrer, de se recycler, ils diminuent l’érosion des sols et créent des corridors écologiques propices à la vie. On peut ainsi dessiner des paysages très beaux et résilients par rapport à ces phénomènes de sécheresses et de précipitations intenses.
En complément viennent des pratiques visant à conserver des sols vivants, comme les engrais verts ou une couverture permanente… Des sols riches en matière organique et bien structurés, avec des micro- et des macroporosités, absorberont et stockeront mieux l’eau. On a lancé de premières expérimentations avec des agriculteurs volontaires dans la vallée du Rhône. Et on a des retours d’expériences venant d’Australie, d’Inde, du Canada, de Turquie, d’Espagne, de Grèce, de Slovaquie...
Et en dehors des paysages agricoles ?
Ces principes peuvent être appliqués en ville, en désimperméabilisant les sols. Quant aux cours d’eau, il s’agit de les renaturer, de recréer des méandres, des zones humides… On peut aussi s’aider d’un allié comme le castor, qui sait où faire ses barrages pour ralentir le courant. L’idéal serait de régénérer tout le cycle de l’eau à l’échelle d’un bassin versant, à la fois dans les champs, les forêts, les villes et les rivières.
Ces solutions tranchent avec la politique actuelle qui privilégie le stockage artificiel dans des retenues, n’est-ce pas ?
En effet, ce sont des solutions fondées sur la nature, qui diffèrent des réponses simplement techniques comme les mégabassines. L’agriculture peut avoir besoin de stocker de l’eau dans des retenues, sous certaines conditions. Mais des grands ouvrages peuvent aggraver le problème en créant des conflits dans le partage de la ressource : stocker pour quoi, pour qui ? Sans parler de l’hydrologie, car l’eau captive ne profitera ni aux milieux aquatiques ni aux nappes. En résumé, ces méthodes de rétention devraient s’accompagner automatiquement d’une évolution vers des pratiques régénératrices, comme l’agroécologie ou l’agroforesterie, ce qui n’est pas le cas.

Quelles représentations différentes de l’eau affleurent derrière ces diverses solutions ?
On a depuis longtemps considéré l’eau comme une ressource, un capital, voire un bien à privatiser. Aujourd’hui, on avance vers une nouvelle représentation de l’eau comme un bien commun, pas seulement pour les humains, mais pour l’ensemble du vivant. Cela apparaît dans des mesures comme le maintien d’un débit réservé à l’aval des barrages – qui permet de laisser un minimum d’eau s’écouler – ou d’un débit biologique dans les rivières, indispensable à la vie aquatique. On prend de plus en plus en compte les habitats naturels dans la gestion des rivières et des prélèvements. Cela va dans le sens d’un meilleur partage. Je reste donc optimiste, mais lucide, car dans les faits, les intérêts économiques continuent très souvent de primer sur les intérêts écologiques.

Cet article est extrait de la Revue Salamandre
Catégorie
Ces produits pourraient vous intéresser
Poursuivez votre découverte
La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille
Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous
Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature
Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique
merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur