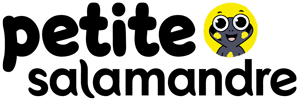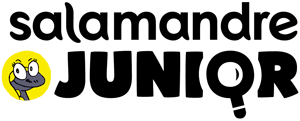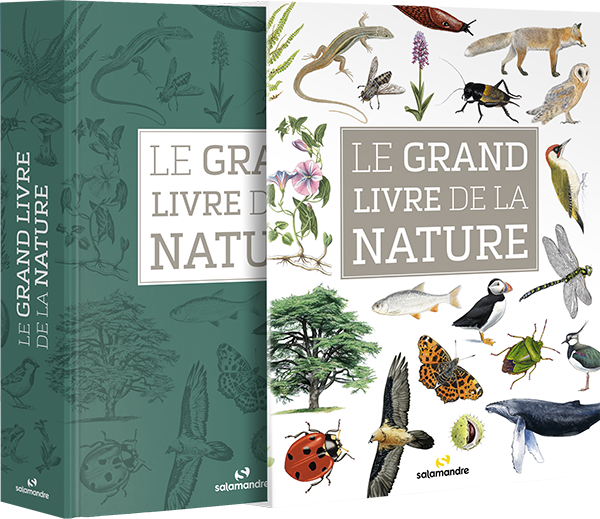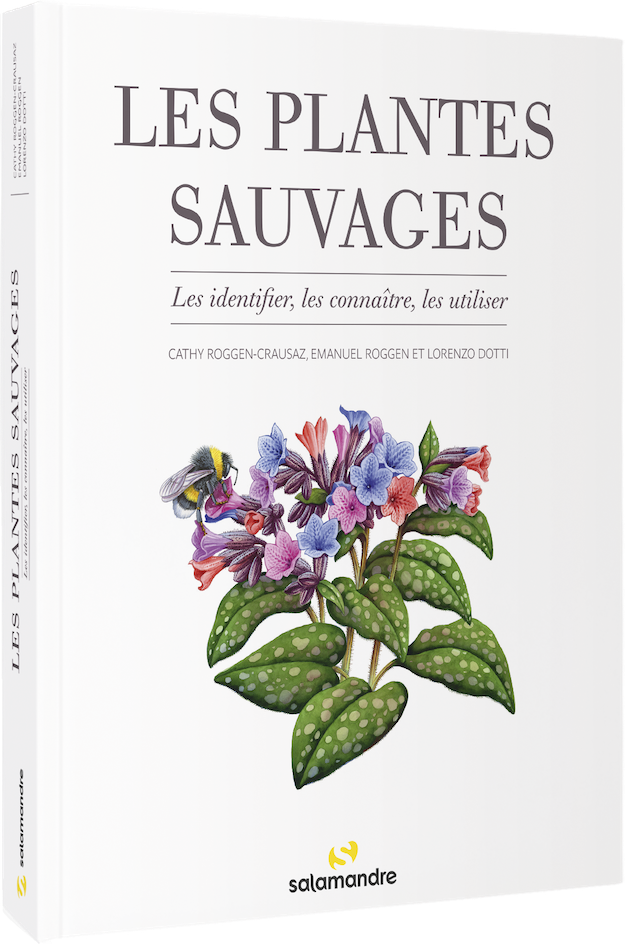«Nous sommes des partenaires», raconte Philippe Descola
L’anthropologue français Philippe Descola est l’un des penseurs majeurs du vivant. Il s’est surtout fait connaître en 2005 avec l’ouvrage de référence Par-delà nature et culture. Il y décrit comment la civilisation occidentale a défini la nature comme un espace extérieur au monde des humains. Il nous partage sa vision d’une possible cohabitation entre citadins et vie sauvage.
L’anthropologue français Philippe Descola est l’un des penseurs majeurs du vivant. Il s’est surtout fait connaître en 2005 avec l’ouvrage de référence Par-delà nature et culture. Il y décrit comment la civilisation occidentale a défini la nature comme un espace extérieur au monde des humains. Il nous partage sa vision d’une possible cohabitation entre citadins et vie sauvage.

Passion Amazonie
Né en 1949, l’anthropologue Philippe Descola a consacré une partie de sa carrière universitaire à observer le mode de vie des Achuar, un peuple autochtone d’Amazonie équatorienne. Il a occupé la chaire Anthropologie de la nature au Collège de France de 2000 à 2019.
Bonjour Philippe Descola. Avez-vous rencontré un animal ce matin ?
J’habite dans une maison en banlieue ouest de Paris et je travaille au fond du jardin. Je fais de nombreuses rencontres avec le vivant et nous échangeons des salutations quotidiennes avec le rougegorge quand je me rends à mon bureau. C’est lui qu’on entend là, il est bien en voix ce matin. Je suis chanceux. C’est une situation un peu exceptionnelle pour un citadin.
L’Île-de-France est l’une des régions les plus peuplées d’Europe. Comment décririez-vous la relation des Franciliens avec le vivant ?
Il y a des endroits qui sont dédiés au vivant à Paris. J’étais hier dans un lieu que je ne connaissais pas encore, le parc de Bercy. Il a été créé sur les anciens entrepôts de la halle aux vins. C’est un îlot dans la ville, qui a été aménagé délibérément pour offrir aux habitants une respiration et un contact avec la faune et la flore.
Mais autrement, dans cette mégalopole, le vivant a une présence adventice, comme on dit pour les mauvaises herbes. Je passe tous les matins devant un immeuble où il y a de l’ailante.
Cette plante originaire d’Asie est extrêmement résistante et pousse entre les interstices du pavé. De la même façon, il arrive de voir une corneille en train de défoncer un sac-poubelle, ou avec plus de chance, un hérisson sortir d’un tas de bois dans une cour obscure. Mais les non-humains sont surtout tolérés de façon permanente dans les endroits spécialement aménagés pour eux.
La nature est-elle devenue une notion extérieure à la cité ?
Cela a toujours été le cas. Mais, dès la fin du XIXe siècle, il y a eu la volonté de faire entrer la nature dans la ville. Dans de grands centres urbains en Europe, par exemple de manière nette en Allemagne, à Berlin ou Munich, de grands parcs ont été créés pour introduire cette respiration. Cela a aussi été le cas à Paris, avec le bois de Boulogne ou les Buttes-Chaumont.
Il s’agissait d’introduire une réalité extérieure dans la ville. La nature est un concept qu’on a inventé en Europe pour distinguer les non-humains et les humains et qui suppose une distance. Il y a aujourd’hui de nouveau un désir de ramener la nature en ville et de retrouver une unité perdue, qui a été très manifeste à l’époque du romantisme au XVIIIe siècle. C’est pétri de bonnes intentions et c’est nécessaire, mais ce n’est pas ça qui va nous faire sortir du naturalisme.

À quoi ressemblerait une ville vivante ?
C’est une question difficile. J’en ai parlé souvent avec des architectes et ils ont conscience de cet enjeu. Lors de nouvelles constructions, cela suppose de ménager systématiquement des espaces de friches, c’est-à-dire des milieux de vie qu’on pourrait laisser se développer par eux-mêmes. Les immeubles seraient conçus de telle façon qu’une partie de chaque étage serait végétalisée. Je comprends bien que cela pose des difficultés. Mais l’urbanisme a trop souvent raisonné en termes de contrôle du jardin.
Les interactions des habitants d’un immeuble avec leur environnement végétal ou animal sont des rapports de satisfaction esthétique. Dans beaucoup de villes déjà constituées, cette idée de friches en libre évolution semble cependant difficile à aménager. On voit mal comment modifier des métropoles comme Paris ou Genève autrement que dans leurs marges lointaines, alors que là, l’idée est de mettre du végétal ou de l’animal au cœur de la ville.
Ecouter en replay l'émission "La nature en ville" sur France Inter, avec Julien Perrot et Philippe Descola :
Sur Terre, plus de la moitié de l’humanité vit désormais en ville. Est-ce que l’expérience du sauvage s’éteint en nous ?
Oui, c’est probable. Mais je pense qu’il faut nuancer en fonction des lieux et des traditions culturelles. La moitié des Indiens d’Amazonie vit maintenant dans les villes, mais souvent avec un système de double résidence. Ils reviennent dans leur village une partie de l’année et le reste du temps ils peuplent les villes, car ils y trouvent leur moyen de subsistance ou y étudient.
Ils conservent donc un lien fort avec le vivant qui les entoure. J’ai passé quelques jours dans un bidonville à Formosa, dans le nord de l’Argentine où habitent des Indiens Toba. Ils vivent du recyclage des déchets dans un environnement très pollué, mais ils sont conscients d’un monde non humain que les autres citadins ne voient pas. De la même façon, l’habitat pavillonnaire, qui est en principe en partie dans la nature, est constitué de petites maisons dont les occupants ont pour beaucoup d’entre eux un rapport distant ou une méconnaissance du milieu.
Peuvent-ils reconnaître des oiseaux à la vue ou à leur chant, peuvent-ils identifier les fleurs sauvages qui poussent le long des routes dans leur lotissement ? Pour la majorité, je crois que ce n’est pas le cas.
Le philosophe Hartmut Rosa dit que dans notre monde urbain où tout va très vite, l’humain doit entrer en résonance avec un élément du monde pour trouver un sens à son existence. Le vivant peut-il être cette résonance ?
Je me méfie beaucoup de l’usage du mot vivant, qui s’est répandu comme une traînée de poudre lors des dernières années. Je pense que des gens qui m’ont lu ont fini par comprendre que la nature était un concept qui était propre à la modernité. Le mot vivant a tendance à remplacer cette nature.
Or, le vivant fait partie d’un environnement qui ne l’est pas toujours et qui permet à des êtres de se développer. Une rivière, une mare, un vent dominant, l’ensoleillement contribuent au déploiement de ce vivant et à sa perpétuation.
Mais l’idée de Hartmut Rosa autour de l’accélérationnisme est juste. Lorsqu’on vit en contact avec des milieux de vie qui n’ont pas été trop anthropisés, qui sont encore animés par une vie propre, on se plie à des rythmes tout à fait différents de ceux de la ville. Cela permet de ralentir.

Vous avez écrit que les Achuar, un peuple d’Amazonie, ont des partenaires sociaux non humains. Qu’entendez-vous par là ?
Un partenaire social non humain, c’est simplement une plante ou un animal avec lequel on peut communiquer. Ils ont une âme, une apparence différente de la nôtre, mais on peut s’adresser à leur subjectivité en leur envoyant des messages. Ce sont des êtres avec lesquels on échange.
C’est le même genre de dimension sensible que nous entretenons en Occident avec nos animaux domestiques, les chiens, les chats, les canaris. Si on est disposé à leur prêter attention, on doit les traiter avec plus d’égard. Il ne faut pas avoir de pitié pour eux, mais les prendre au sérieux. Ce n’est pas une sacralisation, cela n’empêche pas de cueillir des plantes, de les manger ou de chasser le gibier avec lequel on a communiqué. Mais nous sommes des partenaires, des êtres à égalité.
En ville, il y a un apprentissage de cet espace urbain. Il m’est arrivé d’aller avec des Achuar à Quito, la capitale de l’équateur. Le jardin zoologique les fascinait. Ils pouvaient observer des animaux, en captivité, de tout près. Ce qui n’est jamais le cas en forêt où la densité des arbres est très forte. De même, récemment, lorsque j’étais dans le jardin d’amis à Rio, au Brésil, un toucan venait régulièrement dans un arbre. Cet oiseau assez commun dans la forêt tropicale s’y montre difficilement.
Peut-on être aussi proche du vivant en ville qu’à la campagne ?
La classe politique, par ses discours, participe à entretenir une opposition entre ruraux et urbains. Il y a en réalité des urbains qui s’efforcent de préserver des jardins ouvriers ou des parcelles de culture en ville, et qui sont très attentifs aux données écologiques de ces lieux.
Et puis, à la campagne, il y a toute une gamme d’habitants, de ceux qui ont de très solides savoirs naturalistes à d’autres qui sont assez ignorants du monde dans lequel ils vivent. Dans le Sud-Ouest de la France que je connais bien, il y a une pratique qui réunit beaucoup de gens : la cueillette des champignons. C’est une façon, pendant une partie de l’année, d’entretenir des rapports de proximité avec la forêt, et d’y être attentif. Au fond, ce qui compte c’est d’être observateur.
Comment encourager l’humain à être à nouveau curieux de ce qui l’entoure ?
Il n’y a qu’une façon que je connaisse : par l’éducation. Je suis grand-père et j’essaie de le faire avec mes petits-enfants chaque fois qu’on a l’occasion d’aller se promener. J’ai reçu une partie de cette curiosité de mon grand-père, un homme qui adorait herboriser. C’est un savoir qui devrait idéalement être transmis par l’institution scolaire.
Des efforts sont entrepris maintenant, mais ce sont souvent des efforts individuels qui sont le fait de professeurs éclairés.
Pour développer l’enseignement de ce qu’on appelait jadis les leçons de choses, il faudrait un mouvement global. Essayons de susciter l’émerveillement devant la beauté d’un chant d’oiseau ou la complexité d’un milieu naturel. Cela peut aussi être utilitariste en apprenant quelles plantes peuvent être consommées.

Dans ces marges urbaines, y a-t-il justement un type de lieu que vous appréciez particulièrement pour entrer en interaction avec nos voisins sauvages ?
Je chéris les jardins botaniques. Il y en a dans presque toutes les villes. C’est un endroit un peu particulier. À la fois un témoignage de l’obsession de l’Occident pour l’organisation du vivant en catégories, la collecte, la connaissance exhaustive d’espèces, et en même temps ce sont souvent des endroits peu fréquentés, où on trouve des plantes qu’on ne voit pas de façon ordinaire. À Paris, j’apprécie le Jardin des Plantes, qui s’est beaucoup transformé au fil des dernières décennies. On visite un grand lieu de savoir sur la faune et la flore.
J’ai aussi la chance d’habiter pas très loin de la Seine. J’apprécie me promener au bord du fleuve dans une des dernières grandes friches d’Île-de-France. C’est une île qui s’est remblayée au fil du courant, qui a été comblée ensuite par le dragage des chenaux. Derrière des espaces aménagés pour les citadins avec notamment un golf, on trouve un espace où plantes et animaux se déploient sans obstacle. J’aime précisément ces lieux qui ont une certaine liberté dans leur expression.
De nombreux collectifs citoyens ou des élus cherchent à modifier le visage de la ville tant décriée. Est-ce que vous sentez une force en action ?
Il y a des initiatives sans aucun doute. Un mouvement urbain assez ample de gens qui veulent changer leur manière d’habiter la ville se forme ici et là. Cela demande du temps et de la détermination comme tous les mouvements démocratiques.
L’appui que j’ai pu apporter à des mouvements comme Les soulèvements de la Terre ou à des ZAD en France tient à ma conviction profonde qu’il est de notre devoir citoyen de s’engager pour transformer les choses. Cela dit, je ne vais pas faire d’évangélisation, on essaie de faire comprendre une situation au plus grand nombre de personnes et ce sont ensuite à elles de se mobiliser.
Pour terminer cet entretien, y a-t-il une espèce que vous voyez davantage qu’avant à Paris ?
Une espèce est difficile à voir, et lorsque je l’aperçois c’est toujours un grand moment. Il s’agit du renard. Pendant la période du confinement, lors de l’épidémie de Covid-19, il y avait très peu de circulation automobile et les renards ont commencé à montrer le bout de leur nez.
C’est extraordinaire, car je me suis rendu compte qu’ils étaient beaucoup plus nombreux que je ne le pensais. C’est un animal dont la symbolique est très chargée en Europe et qui représente aussi l’un des derniers grands indépendants. À la différence du loup qui fait peur et est beaucoup moins présent, le renard n’effraie pas trop les humains, sauf ceux qui ont des poules !
Un peu de vocabulaire...
*Friches
La friche fait souvent peur. Dans le monde agricole, elle désigne un terrain anciennement cultivé et désormais abandonné aux forces de la nature. C’est l’indice d’un exode rural, notamment dans les régions montagneuses. En ville, cet espace qui a perdu sa vocation initiale, industrielle ou commerciale, inquiète aussi. Il est le territoire des herbes folles, des ronces, de la ferraille tordue.
Pourtant, la friche urbaine est une chance pour les cités. Elle offre au sauvage un lieu sans présence humaine et constitue un îlot de végétation. À Lyon, la municipalité écologique a décidé de préserver des friches urbaines en annulant des projets d’urbanisation prévus par le plan local d’urbanisme et de l’habitat.
*Accélérationnisme
Notre société appuie toujours plus sur la pédale de vitesse, au risque de l’autodestruction. C’est en tout cas ce qu’affirment les idéologues de l’accélérationnisme. Ce que suggère ce concept philosophique, c’est qu’une fuite en avant du capitalisme pourrait entraîner son explosion.
Certains estiment donc que la solution pour changer d’horizon civilisationnel serait de rouler encore plus vite sur l’autoroute de la surconsommation.
De manière différente, le penseur Hartmut Rosa a théorisé l’accélération sociale. Contrairement à sa promesse, le progrès ne laisse pas plus de temps libre aux humains. Les technologies accaparent davantage d’heures qu’elles n’en font gagner. Surtout, l’innovation technologique ultra-rapide a déteint sur notre identité personnelle : pour réussir sa vie, il faut sans cesse la remplir de projets... parfois jusqu’au burn-out.
*Naturalisme
C’est sans doute l’animal le plus présent dans les pages de la Revue Salamandre... le naturaliste. Que dit de lui le dictionnaire ? Qu’il est un spécialiste des sciences naturelles : botaniste, minéralogiste, zoologiste... Mais ce n’est pas tout.
Le naturaliste peut aussi être celui « qui s’inspire du naturalisme ». Les choses prennent un tournant différent puisque ce courant de pensée est une conception selon laquelle tout ce qui existe peut être expliqué par des causes ou des principes naturels.
Exit l’intervention divine. Selon Philippe Descola, la société naturaliste à la sauce occidentale produit une frontière entre humains et non-humains. Le concept de nature sous-entend implicitement une séparation du monde entre nature et culture. Les animaux ne sont pas les égaux des humains,
Cet article fait partie du dossier
Villes vivantes
-
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciLa ville qui gratte le ciel et grignote la campagne
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciLe grand retour du castor dans nos cités
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciLe castor en ville : 3 questions à Cécile Auberson, biologiste
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciPollution lumineuse, le côté obscur de la ville
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciÀ Genève, des missions nocturnes pour protéger la faune
-
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciÀ Bruxelles, les lignes vertes
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici«Nous sommes des partenaires», raconte Philippe Descola
Abonnés -
 Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’ici
Nature d’iciVive les balcons !
Abonnés

Cet article est extrait de la Revue Salamandre
Catégorie
Ces produits pourraient vous intéresser
Poursuivez votre découverte
La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille
Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous
Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature
Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique
merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur